ANNE MOUNIC
Keywords
World War I, Katherine Mansfield
Abstract
Experience can be paradoxal for a woman: Katherine Mansfield was near the armed zone in 1915 as she tried to meet Francis Carco, an author of popular novels and poet, as well as her lover. She told the story of that February 1915 journey and seven years later again wrote about the same conflict using the figure of the serpent in an epic twist.
Résumé
L’expérience est paradoxale pour une femme, l’intrusion est indiscrète, voire inconsidérée : Katherine Mansfield s’est trouvée en 1915 tout près du théâtre des opérations, dans ce qu’on appelait à l’époque la « zone des armées »[1], afin d’y rencontrer Francis Carco, romancier populaire, poète, et son amant. Elle raconte ce voyage (février 1915), dans lequel elle frôle le tragique sans y acquiescer,[2] en mai de la même année. Sept ans plus tard, elle revient sur cette guerre en faisant sienne la douleur causée par ce « froid serpent »[3] qui hante l’univers pastoral et apparaît, sous forme d’un « nœud de serpents »[4], dans « The Wind Blows / Le vent souffle ». Dans les deux nouvelles, « Voyage indiscret » et « La Mouche », figures du pouvoir et figures tragiques se confondent tandis que la vie, humble, cruelle et savoureuse, prend un tour épique. Le mouvement de l’aventure, fou et éperdu, la révèle dans sa réalité et ses détails éloquents. La vie immédiate s’exalte dans l’instant mémorable du retour sur soi du récit. Je me propose d’étudier ces deux aspects. Comme la traduction de ces deux nouvelles m’a permis d’en approfondir la lecture, je mettrai ensuite en valeur le relief que donne à l’œuvre originale sa traduction.
____________________
Tragique, inerte, abstrait
Les figures tragiques, dans ces deux nouvelles, sont des figures de pouvoir risquant de faire obstacle à la volonté individuelle, jusqu’à mettre en péril la vie elle-même. Au cours de l’escapade de la narratrice, dans « Voyage indiscret », on rencontre tout d’abord, à la gare, le « Commissaire de Police ; de l’autre, un officier Sans Nom. Me laissera-t-il passer ? »[5] Notons que le premier n’a pour seul nom que sa fonction, ce qui les rend tous deux d’autant plus abstraits, même si le « Commissaire » s’incarne lourdement par sa laideur : « C’était un vieil homme à l’épais visage tuméfié, couvert de grosses verrues. Accroupies sur son nez, des lunettes à monture d’écaille. »[6] Cette pesanteur charnelle contraste avec la grâce et la légèreté de la narratrice, dont le sourire « du petit matin », comme un papillon, va « voleter contre les lunettes d’écaille »[7] et tomber. La figure d’autorité suivante est une femme, qui défend la sévérité de l’armée et prédit à la voyageuse qu’elle ne pourra guère quitter la gare de X. La nécessité est invoquée ; le nom de la gare d’arrivée se voit bientôt qualifier de « fatal »[8]. Cette dame peu amène porte un chapeau sur lequel est « couché » une « espèce de mouette »[9] ; la phrase mêle le français et l’anglais ; l’accord du participe passé n’est pas fait. L’oiseau devient accusateur dans l’imagination de la narratrice, bientôt « terrifiée »[10], jusqu’à en avoir le souffle coupé.
Et l’on retrouve à la gare d’arrivée le même type de configuration qu’à Paris, « deux colonels assis derrière deux tables »[11]. Le mot ne prend pas de majuscule, à la différence de la première épiphanie, mais le lecteur ne perd rien pour attendre puisque, une fois leur air qualifié de « superbe et tout-puissant »[12], ils deviennent, tout naturellement, « Dieu 1er » et « Dieu 2nd »[13]. Nous atteignons, dans l’effroi de l’interdit, une forme de transcendance absolue : « J’éprouvai le terrible sentiment, en tendant mon passeport et mon ticket, qu’un soldat allait s’avancer et me demander de me mettre à genoux. Je me serais agenouillée sans poser de question. »[14] Ce divin, considéré dans sa toute-puissante grandeur, est toutefois mis à mal par la capacité d’esquisse, rapide et précise, de l’auteur, qui donne aux deux personnages une réalité charnelle contredisant l’abstraite rigueur de leur absolutisme : « Leur tête roulait sur leur col serré comme un gros fruit trop mûr. »[15]
Plus tard, les soldats bravent l’interdit qui pèse sur eux ; ils se cachent pour boire au café, où ils ne devraient pas se trouver après huit heures du soir. La menace, réelle, est formulée par la patronne du « Café des Amis » qui craint qu’ils n’attirent chez elle les gendarmes. Toutefois, dans ce monde parallèle, où l’ami supplante l’ennemi ainsi que l’ennui,[16]la figure d’autorité, réduite à un bruit de pas, perd de sa toute-puissance, comme absorbée dans la puissance de vie du monde pastoral : « Les gendarmes poussent ici partout aussi serrés que les violettes. »[17]
L’opposition entre continuité pastorale et rupture tragique structure « La Mouche », écrite sept ans plus tard, alors que Katherine Mansfield se savait malade de la tuberculose depuis 1917 et souffrait beaucoup. Tout comme son fils, alors que celui de Woodifield se nomme Reggie, le personnage dénommé « le patron »[18] demeure anonyme, seulement caractérisé par son pouvoir, (sans majuscule toutefois), ainsi que par son deuil, qui fige le devenir jusqu’à l’inerte. Si Woodifield nomme son fils par son prénom, le « patron » ne le nomme que par rapport à lui-même, comme son fils, dans un rapport de possession. La continuité pastorale, incarnée par l’ami, le « vieux Woodifield »[19], ou « Champ boisé », s’avère double. Elle est à la fois le renouveau des beaux jardins et des allées « belles et larges »[20], fussent-elles celles des cimetières militaires de Belgique, et le lent travail de décomposition que l’abstraction du pouvoir ne peut admettre : « Cela avait été un choc terrible quand le vieux Woodifield, de but en blanc, avait énoncé cette remarque sur la tombe. Il avait eu exactement l’impression que la terre s’était ouverte et qu’il avait vu le garçon, gisant là sous le regard des filles du bonhomme. Car c’était étrange. Bien que plus de six années eussent passé, le patron ne songeait jamais au jeune homme autrement que couché, pareil à lui-même, parfait dans son uniforme, pour un sommeil éternel. ‘Mon fils !’, gémit-il. »[21] L’inertie que le refus de la métamorphose impose au devenir s’incarne dans la photographie du jeune soldat posant en uniforme dans un univers factice. « Le jeune homme n’avait jamais ressemblé à cela. »[22]
La rupture que la mort inflige au cours du temps et, du point de vue du pouvoir, à l’ordre des choses, invite au sacrifice, qui est une exaltation du tragique dans une forme d’abstraction esthétique. « Dans toutes les grandes tragédies, » écrivait W.B. Yeats en 1936, « celle-ci est une joie pour l’homme qui meurt ; en Grèce, le chœur tragique dansait. […] Si la guerre est nécessaire, ou nécessaire à notre époque et chez nous, le mieux est d’oublier ses souffrances comme nous oublions le malaise de la fièvre en nous rappelant notre réconfort à minuit quand la fièvre tomba, ou comme nous oublions les pires moments d’une plus douloureuse maladie. »[23] Face à la souffrance de la mouche, qui cherche à récupérer ses ailes et son souffle après être tombée dans l’encrier, le patron oppose une « idée », puis une « idée brillante »[24], toutes deux consistant à offrir une issue fatale à la lutte de l’insecte pour vivre. Katherine Mansfield convoque subrepticement la présence de la faux, comme si le geste salvateur devait appeler sur elle avec plus d’ardeur la fatalité incarnée par « le patron » : « Dessus, dessous, dessus, dessous, la patte essuyait l’aile comme la pierre aiguise la faux, dessus, dessous. »[25] En effet, son « admiration pour le courage de l’insecte »[26] le conduit à aggraver l’expérience, jusqu’à la mort. On songe à ce que suggère Hawthorne sur l’indifférence scientifique dans « The Birthmark » (1843) et « Rappacini’s Daughter » (1844). On sait aussi qu’Aristote affirmait que le spectacle de la tragédie devait purifier les émotions de pitié et de crainte. Une fois le cadavre de la mouche évacué dans la corbeille à papier, « le patron » connaît enfin l’oubli, qui fait écho à celui de Woodifield, au début, tout en lui étant contraire, puisque motivé par une rupture : « Tandis que le vieux bougre se retirait à pas feutrés, il se mit à se demander à quoi il était en train de penser auparavant. Qu’était-ce ? C’était… Il sortit son mouchoir et le passa sous son col. Drôle de vie ; il ne se souvenait absolument pas. »[27] Woodifield, lui, était pris par la jouissance du moment présent alors que le patron est toute volonté. Il décide du sort de la mouche puisqu’il ne peut gouverner ses émotions. Le sacrifice lui redonne une illusion de maîtrise sur sa propre personne. La catharsis est accomplie.
La vie, par-delà la rupture, est restaurée, mais c’est au prix d’une perte de l’instant, d’une aliénation à la réalité de la vie charnelle. On entrevoit deux points de vue : tout d’abord, une esthétique de la compensation face à une nécessité souveraine, que décrit Rachel Bespaloff dans son étude sur l’Iliade (entreprise dès 1939 et publiée à New York en 1943) en parlant de « rédemption par la beauté »[28], ou un sursaut éthique visant à restaurer la vie dans son flux continu : « L’éthique elle-même n’est avant tout qu’un instant de résurrection, une insurrection de la force finie contre sa propre déchéance et sa corruptibilité. »[29] Le récit, enraciné chez Katherine Mansfield dans cette ambivalente continuité pastorale, provoque cet « instant de résurrection » comme l’indique la fin de la nouvelle intitulée « Feuille d’Album » : « ‘Excusez-moi, Mademoiselle, vous avez fait tombé ceci.’ Et il lui tendit un œuf. »[30] On voit à l’œuvre une éthique de l’individu étreignant, comme la mouche, cette extériorité qui lui résiste afin de naître, dans ce retour sur soi de la conscience, comme sujet.
Continu, pastoral, épique
Le récit s’inscrit dans la réalité charnelle grâce aux notations précises, tenant du croquis rapide, voire de la caricature, que j’ai signalées. Nous pouvons également mentionner, dans « Voyage indiscret », le « petit soldat, tout entier bottes et baïonnette. Il avait l’air triste et perdu, tel un petit dessin comique attendant la blague à écrire au-dessous »[31]ou les soldats français imprimés sur la « poitrine » du pays « comme de vives décalcomanies irrévérencieuses »[32]. Les deux notations marquent tout à a fois l’empathie de l’auteur à l’égard des conscrits et un jugement, léger, sur le ridicule de cette guerre.
Dans « La Mouche », la sincérité de Woodifield est soulignée par la comparaison : « à la façon dont un bébé, dans son landau, scrute les alentours »[33]. Quant à la position de pouvoir du patron, elle est accentuée par l’attitude de son domestique, qui « entrait et sortait de son cagibi à la façon d’un chien qui s’attend à être emmené en promenade »[34]. Dans les deux nouvelles, les notations pastorales se superposent au tragique comme pour le confondre. La narratrice croit voir des fleurs dans les cimetières au mois de février : « Ce sont des bouquets de rubans attachés aux tombes des soldats. »[35] Admirant la campagne qu’elle aperçoit du train, elle pose la question : « a-t-on livré des batailles dans de tels lieux ? »[36] Comme, chez Shakespeare, les lieux pastoraux que sont la forêt d’Ardennes ou celle de Bohême permettent de corriger la corruption de la cour (As You Like It / Comme il vous plaira, 1600) ou le tragique induit par le monarque absolu (The Winter’s Tale / Le Conte d’hiver, 1611), dans « Voyage indiscret », ils rendent la guerre irréaliste, voire impossible. Elle devient, littéralement, contre-nature. Dans « La Mouche », Woodifield décrit le cimetière comme un beau jardin avant de parler de l’anecdote du pot de confiture, facturé trop cher à l’hôtel. Le renouveau pastoral garantit la continuité de la vie. Le « temps est la miséricorde de l’éternité »[37], comme l’écrivait William Blake dans Milton(1804-1808). Shakespeare le soulignait déjà dans The Winter’s Tale / Le Conte d’hiver lorsqu’il faisait apparaître, au début du quatrième acte, le Temps, jouant le rôle du Chœur, afin de réparer la perte occasionnée par l’absolutisme de Leontes. Il est en son pouvoir de « renverser la loi »[38] ainsi que d’instaurer et de dépasser la coutume. Le récit épouse cette qualité tout ambivalente, mais parfois rédemptrice, du devenir. Jaques l’exprime dans As You Like It / Comme il vous plaira :
Ainsi d’heure en heure, nous ne cessons de mûrir,
Et puis d’heure en heure, nous ne cessons de pourrir ;
Et par ce moyen se noue le conte.[39]
Fidèle lectrice de Shakespeare, Katherine Mansfield envisage le récit comme reprise, au sens kierkegaardien du terme. Nous l’avons vu. L’abondance d’onomatopées dans le récit donne au lecteur le vif sentiment de l’immédiat. Une continuité s’établit, de la vie au récit. Ajoutons que l’auteur nomme Kezia, fille du Job à qui Dieu restitue ce qu’il a perdu, (ce que le philosophe danois nomme « reprise »[40] en 1843), la petite fille qui la représente dans ses nouvelles d’enfance. La mort de son frère en 1915 l’incita à payer à leur pays et à leurs jeunes années cette « dette d’amour »[41]. « Je t’aime je t’aime », écrit-elle ensuite. « Les mots ressemblent à des fleurs. »[42] Il s’ensuit que lorsque les gendarmes se confondent avec des parterres de violettes, ils perdent de leur aspect menaçant. Le récit s’arroge le pouvoir fécondant de la nature, sa capacité d’infini. On songe ici au célèbre poème de Wordsworth, auquel pense Katherine Mansfield, dans « Bliss / Félicité », lorsqu’elle fait fermer les yeux à son personnage, qui voit « sur ses paupières le joli poirier et ses fleurs grand ouvertes comme le symbole de sa propre vie »[43]. Les jonquilles du poète romantique « s’étiraient en une ligne infinie »[44].
Le récit affirme également la continuité de la vie et son infini en se situant à la suite des autres récits, qu’il peut mêler à son propre tissage. Dans ses Carnets, Katherine Mansfield se montre soucieuse du suivi de l’histoire littéraire : « Quand je lis une pièce de Shakespeare, je veux être capable de la situer en relation avec ce qui est venu avant & vient ensuite. »[45] Elle exprime aussitôt le même intérêt en ce qui concerne la Bible, qu’elle dit lire beaucoup. Dans « Voyage indiscret », nous avons déjà trouvé la représentation de la Trinité, avec Dieu 1er, Dieu 2nd et une mouette parodiant le Saint-Esprit sur un chapeau, mais la référence biblique, plus étendue, constante, nous mène plus loin. Elle s’impose dès l’abord, par cet énigmatique début : « Elle ressemble à Sainte Anne. »[46] Suit une allusion à Sainte Blandine ou au Livre de Daniel (6, 17-25), auquel elle fait allusion, par l’image de la « fournaise ardente »[47] (Daniel 3, 15) dans « The Doves’ Nest / Le nid des colombes », nouvelle écrite en Suisse en janvier 1922 : « En Burberry, on a fait face aux lions. »[48] Le départ de la narratrice donne l’impression d’une fuite éperdue vers un ailleurs indéterminé, les noms des villes se transformant en simples lettres. L’espace se modifie comme le temps, puisqu’elle n’a plus sa montre. Vient ensuite l’homme qui porte des poissons dans un seau : « Il ressemblait à une figure échappée de quelque image sainte, paraissant implorer le pardon des soldats pour sa simple présence… »[49] Nous nous apercevons que l’un des dieux fume « ce que les dames adorent appeler une grosse cigarette égyptienne »[50]. Vient ensuite la fin des temps, dans le café, qui nous projette dans l’Apocalypse. Les visages, dans le Café des Amis, rappellent « une famille réunie pour le repas du soir, dans le Nouveau Testament »[51]. L’évocation de la mère de la Vierge pour désigner cette concierge si maternelle à l’égard de sa locataire, place la narratrice dans le rôle de Marie ; l’adjectif qualifiant la cigarette nous conduit en Egypte. La fuite en Egypte fut causée par le Massacre des Innocents : la narratrice décrit les soldats perdus, blessés, ne pouvant, comme des enfants, s’empêcher de pleurer. Elle juge l’événement de façon allusive, discrètement, tout en montrant à quel point la vie se poursuit malgré tout dans cette atmosphère d’apocalypse. Elle suggère que tout cela est une mascarade par l’emploi de métonymies (« une baïonnette »[52] désignant, par exemple, le soldat qui la porte). Entre Nativité (le contrôleur utilise des « forceps »[53] pour poinçonner le ticket) et fin des temps, elle se révèle dans sa complexité. Dans les deux nouvelles, on boit du whisky, qui n’est autre que de l’eau-de-vie. C’est le dernier mot de « Voyage indiscret ». La vie se recrée dans le récit grâce aux caractérisations quasiment homériques (le soldat aux yeux bleus) et aux noms comme issus directement de contes (Barbe Noire). Le temps du récit embrasse le commencement (la Nativité) et « le tout dernier jour »[54], ‒ c’est de temps humain et non de chronologie linéaire, ou mécanique, qu’il s’agit, ‒ et met en scène pouvoir et transcendance absolus ainsi que le genre humain dans sa fuite et sa résistance épiques. Ce sont les rôles respectifs du patron et de l’insecte dans « La Mouche ». Le récit y sape les fondements du pouvoir en sa vanité. La description des objets dans le bureau rénové vient en contrepoint à la fierté du pouvoir, quasiment puérile.
Dans cette nouvelle, l’allusion est implicite. On songe au petit poème de William Blake, qui assimile le frêle insecte à l’homme, dont il est par ailleurs victime. En suivant la continuité des figures, le personnage de Gloucester, dans King Lear / Le roi Lear (1604-1605), s’impose, lui qui, victime de la fourberie des filles ingrates du roi, énonce : « As flies to wanton boys, are we to th’Gods;/ They kill us for their sport »[55] (« Comme les mouches victimes de la cruauté gratuite des garçons, nous sommes les victimes des Dieux, / Qui nous tuent pour leur plaisir. ») Le duc, dans la tradition de l’antiquité gréco-latine, impute son sort à la fatalité, comme le personnage de Plaute (252-184 avant notre ère), dans le Prologue des Prisonniers (Captivi) : « … ah, oui ! les dieux se jouent de nous, les humains, comme de balles ! »[56] Dans la tragédie de Shakespeare, le roi renouant avec sa fille, c’est-à-dire avec le personnage loyal et vrai, réintègre la continuité du récit :
so we’ll live,
And pray, and sing, and tell old tales, and laugh
At gilded butterflies, and hear poor rogues
Talk of court news;[57]
c’est ainsi que nous vivrons,
Que nous prierons, chanterons, et dirons d’anciens contes, en [nous moquant
Des papillons dorés et en entendant de pauvres hères
Discuter les nouvelles de la cour ;
Le temps, cependant, n’a pas le loisir de réparer l’erreur tragique, comme dans The Winter’s Tale, où le conte avait été interrompu brusquement par la folie absolutiste du prince, entraînant la mort du conteur et brisant la continuité des générations puisque le conteur était précisément le fils du monarque.
Toutefois, la mouche n’incarne pas seulement la victime. Dans son « Eloge de la mouche »[58], Lucien de Samosate (c. 117-180) se réclame d’Homère qui, dans L’Iliade, compare la bravoure de Ménélas à la « hardiesse de la mouche, qui, si vivement que l’homme la chasse de sa peau, s’attaque à le piquer, car elle aime le sang humain »[59]. Il parle lui-même de « l’audace de la mouche », de « l’intrépidité » et « la ténacité de son attaque ».
La mouche de Katherine Mansfield n’acquiesce guère à la tragédie que lui impose la fatalité du pouvoir absolu, mais, en dépit de sa vaillante résistance, elle est vaincue, prise au piège du sacrifice cathartique. Nous allons voir quels problèmes pose au traducteur la double identification à l’insecte, celle du patron et celle de l’auteur.
Le relief de la traduction
La plume de Katherine Mansfield est précise ; le détail, nous l’avons vu, est évocateur ; le récit manifeste la vie éludant, avec ruse ou avec ténacité, contraintes et tentations de rupture. Ecrire signifie davantage que seulement résister ; l’écrivain ressuscite la vie en sa splendeur. Il s’agit de « renouveler »[60] dans le conte les lieux et les êtres. Nous pouvons, incidemment, remarquer que Lucien de Samosate fait de la mouche une sorte de phénix qui « ressuscite, comme si elle recevait une seconde naissance, et recommence une nouvelle vie. On doit en conclure rigoureusement que l’âme de la mouche est immortelle comme la nôtre, puisque après avoir quitté le corps, elle y revient, le reconnaît, le ressuscite et que la mouche se remet à voler »[61]. L’identification de William Blake à la mouche revient en mémoire, d’autant plus qu’il associe, à la quatrième strophe, la « pensée » à la « vie, / La force & le souffle »[62], notions essentielles ici.
Le souffle, en 1915, n’est pas encore en danger pour l’auteur du « Voyage indiscret », dont le titre pose au traducteur un premier problème. « Indiscreet », en effet, ne recouvre pas tout à fait « indiscret ». La définition donnée par l’O.E.D. est la suivante : « Imprudent in speech or action ; inconsiderate ; unadvised. » En français, « indiscret » se définit ainsi (Robert) : « Qui agit sans discernement, à l’étourdie » (sens ancien). « Qui dénote un manque de jugement, de modération. » « Qui manque de discrétion, de réserve, de retenue dans les relations sociales » (sens moderne). Le problème réside dans le fait que la dernière acception l’emporte sur les deux autres. Je fus tentée de traduire ce titre par « Voyage inconsidéré », mais me suis ravisée. Ce dernier adjectif impose, en effet, d’emblée un jugement qui ferme le sens de la nouvelle au lieu, sur son seuil, d’ouvrir à la subtilité de la suggestion. La manière de Katherine Mansfield étant justement discrète, nuancée et délicate, cette prise de position trop nette ne convenait pas. Son goût du menu détail éloquent s’accompagne d’ailleurs d’une identification à des êtres menus et fragiles, comme le canari de sa dernière nouvelle ou bien, ici, la mouche.
Cette précision de l’infime se révèle, par exemple, dans le mot employé pour désigner le manteau que la narratrice quitte pour endosser son Burberry, la silhouette « peg-top »[63] correspondant à la mode 1908-1914, le vêtement ample se resserrant à l’ourlet. Si le mot, en anglais, évoque une forme, il est beaucoup moins courant en français. J’optai tout d’abord pour un simple « manteau », perdant ainsi la notation visuelle. Je pouvais prendre le parti de la description, ou bien laisser le mot, se référant à l’époque, en l’accompagnant d’une note. La première solution me parut lourde et la seconde, au moins exacte, car elle permet au lecteur de se figurer le vêtement au lieu de demeurer dans le vague.
Comme je l’annonçais plus haut, la fin de « La Mouche » pose des questions de traduction intéressantes. Il n’est pas rare que le passage de l’anglais au français pose un problème de genre grammatical. Ici, la mouche est reprise au neutre, avec le pronom « it » jusqu’au moment où l’on entre dans l’esprit du patron : « He’s a plucky little devil, thought the boss, and he felt a real admiration for the fly’s courage. That was the way to tackle things ; that was the right spirit. »[64] Impossible pour le traducteur français de parler de la mouche puisque le point de vue est masculin. J’ai donc utilisé le mot « insecte » pour cette description de sa hardiesse ancestrale : « C’est un petit diable courageux, songea le patron, qui éprouva une véritable admiration pour le courage de l’insecte. Il avait le coup pour affronter l’adversité ; il réagissait comme il faut. » Toutefois, quelques lignes plus loin, le point de vue change alors que la mouche est tout près de succomber : « He leaned over the fly and said to it tenderly, ‘You artful little b …’ » La narratrice poursuit au neutre, mais l’élision, que j’interprète comme « bitch », impose un féminin. Nous revenons à la mouche, qui ne peut être garce, même si ce mot me paraît le plus juste, car il ne s’éliderait pas, tandis que « p… » supporte l’élision, et la réclamait même, il fut un temps. « Il se pencha sur la mouche en lui disant tendrement : ‘Tu es rusée, petite p…’ » La ruse est une qualité épique, si l’on songe à Ulysse. C’était aussi une caractéristique de Jacob qui, luttant avec l’ange, étreignit l’adversité, se retrouvant à l’aube vainqueur et claudiquant. Dans les deux cas, « little » est utilisé, ce qui nous rapproche de l’humilité picaresque.
Katherine Mansfield elle-même, assimilant les ailes et le souffle, s’identifie à cette mouche qui, bien que petite, refuse de désespérer. La défaite physique ne lui laisse comme issue que le récit. « J’ai détesté l’écrire »[65], écrivit-elle dans une lettre de juin 1922. La figure de la mouche exprime indirectement la vérité de sa propre lutte avec la maladie, de la même façon que les diverses allusions aux Ecritures contenues dans « Voyage indiscret » révélaient indirectement son point de vue. Cet aspect indirect caractérise la communication de l’intériorité et fait du récit un mouvement éthique avant toute chose, c’est-à-dire une affirmation du sujet dans sa vigueur à vivre. Cette force est créatrice de valeurs. Se communiquant, elle transmet le goût de vivre en une sorte de communion des âmes qui n’a rien à voir avec la catharsis tragique. Cette dernière vise à se purifier des émotions de pitié et de crainte, à s’en guérir, tandis que la communion des âmes se fonde sur l’empathie. Il ne s’agit pas d’une esthétique visant à une « rédemption par la beauté » (voir supra), mais d’un élan, le plus souvent empathique, suscitant une résurrection, ou une reprise, dans la continuité du récit. Il fallait que le mot « vie » apparaisse, comme en anglais à la fin de « La Mouche », même si l’expression « For the life of him »[66], ayant perdu son sens premier, y marque seulement que l’oubli est absolu. J’ai utilisé l’expression « Drôle de vie » afin de réintroduire le mot.
En juin 1922, Katherine Mansfield écrivait dans une lettre à Arnold Gibbons, un de ses amis : « … mais comment allons-nous communiquer ces accents, ces demi-tons, ces quarts de ton, ces hésitations, ces doutes, ces commencements si nous les abordons directement ? C’est vraiment diablement difficile, mais je crois fermement qu’il existe un moyen d’y parvenir et que c’est en essayant de s’approcher le plus près possible de l’exacte vérité. »[67] Cet abord indirect se décrit en partie avec des termes musicaux ; c’est également un mouvement vers une véracité toujours plus affinée.
On perçoit, dans les deux nouvelles considérées, le lent dévoilement métamorphique du motif, qui constitue une caractéristique essentielle de l’œuvre de Katherine Mansfield et participe de ce souci de continuité par-delà les ruptures, que nous avons envisagé. Ce fut aussi le souci de bon nombre de poètes qui furent confrontés à la Grande Guerre. Isaac Rosenberg songe à la destruction du Temple de Salomon et, dans son célèbre poème « Daughters of War / Filles de la guerre », la violence des Amazones menace l’arbre de vie. Afin de se figurer l’événement, le poète puise dans le récit ancestral. Robert Graves fit de même en reprenant les sources celtique, gréco-latine et biblique pour édifier une image de la vie prise dans sa cruelle ambivalence. Le récit devient la pierre de touche de l’inconnu que nous réserve le devenir.
On trouve, plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, chez Lynette Roberts[68] (1909-1995), la même opposition entre le monde pastoral et la violence guerrière. Voici un extrait de « Lamentation » :
The living bled the dead lay in their grief
Cows, sheep, horses, all had got struck
Black as bird wounds, red as wild duck.
Dead as icebone breaking the hedge.
Dead as soil failing of good heart.
Dead as trees quivering with shock
At the hot death from the plane.[69]
Les vivants saignaient les morts gisaient dans leur affliction
Vaches, moutons, chevaux, tous avaient été frappés
Noirs comme blessures d’oiseau, roux comme canard sauvage
Morts comme armature de glace brisant la haie.
Morts comme terre à défaut de bon cœur.
Morts comme arbres frissonnant d’horreur
A la mort brûlante que l’avion inflige.
Charles H. Sorley insista lui aussi, durant la Première Guerre, sur la destruction du paysage agraire. On songe aux tableaux de Paul Nash. Je pourrais citer d’autres poètes.[70]
En octobre 1922, Katherine Mansfield, séjournant à Avon (Seine-et-Marne) dans la communauté de Gurdjieff, écrivait : « Il me semble que dans la vie qui se vit de nos jours, la catastrophe est imminente ; je sens en moi cette catastrophe. Je veux, au moins, m’y préparer. »[71] Et elle ajoutait en postscriptum : « Tout ceci a une résonance bien trop sérieuse et dramatique. En réalité, il n’y a là absolument aucune tragédie, bien sûr. »[72] Le mode pastoral est celui de la jouissance de la vie : « Déjà levé et se promenant dans les champs, rose sur les cours d’eau et les étangs cernés de rouge, le soleil se posa sur le train allant à la bonne cadence, caressa mon manchon et me dit d’ôter ce Burberry. »[73] Le monde s’anime dans le regard subjectif. Que l’on songe au célèbre sonnet 33 de Shakespeare, on voit qu’ici le soleil a perdu son « œil souverain »[74] et absolument transcendant et, surmontant la distance de la vue, gagne l’immanence de la caresse. Loin de l’idéal, le monde se rapproche. De même, la voix poétique de Katherine Mansfield se reconnaît dans la mélodie d’un canari plutôt que de solliciter l’ancestral rossignol.[75] C’est une voix menue mais exacte qui anime le monde de sa subjectivité (le soleil caresse ses effets et lui parle) et s’approprie le temps, ainsi que les figures, du récit en renouvelant, au sein du devenir, leur actualité signifiante. Comme nombre de poètes confrontés à cette sorte de réalité, Katherine Mansfield s’inscrit de cette manière, vive et discrète, dans l’esprit du récit.
Chalifert, octobre 2016.
[1] « … je découvre que cet endroit se trouve dans la zone des armées et, par conséquent, interdite aux femmes ». Katherine Mansfield, Letter to J.M. Murry, c. 20 February 1915, in The Collected Letters of Katherine Mansfield, Volume 1, 1903-1917. Edited by Vincent O’Sullivan and Margaret Scott. Oxford : O.U.P., 1984, p. 149.
[2] On trouve l’expression, « acquiescing in the tragedy », dans le roman d’E.M. Forster, The Longest Journey (1907). L’auteur l’assimile à une forme d’« apathie », expliquant, par l’intermédiaire de son héros, qu’il faut pas s’accoutumer au deuil, mais « ne pas oublier » (« mind ») : « Au nom du ciel, n’oubliez pas une telle chose et n’esquivez pas l’élan de votre âme. » / « In God’s name, mind such a thing, and don’t sit fencing with your soul. » E.M. Forster, The Longest Journey. London : Penguin, 2006, pp. 55, 52, 53. Même si elle ne le connaissait pas bien, Katherine Mansfield avait de l’estime pour E.M. Forster. S’expliquant sur l’attrait qu’exerçait sur elle la communauté de Gurdjieff à Avon, elle écrit : « Lui [D.H. Lawrence] et E.M. Forster sont les deux hommes qui pourraient comprendre ce lieu s’ils le voulaient. Mais je pense que l’orgueil de Lawrence l’en éloignerait. » To J.M. Murry, c. 24 Novembre 1924, in The Collected Letters of Katherine Mansfeld, Volume 5, 1922-1923. Edited by Vincent O’Sullivan and Margaret Scott. Oxford : O.U.P., 2008, p. 326.
[3] « Vous qui cueillez les fleurs et les fraises qui naissent au ras du sol, fuyez d’ici, ô enfants : un froid serpent est couché sous l’herbe. » Virgile, Les Bucoliques. Paris : Garnier-Flammarion, 1988, p. 49.
« Le cheval et le froid serpent, c’est ce que je crains le plus, depuis l’enfance. » Bucoliques grecs : Théocrite. Idylle XV, Les Syracusaines. Paris : Les Belles Lettres, 2002, p. 123.
[4] « a coil of snakes » Katherine Mansfiled, « The Wind Blows », in The Collected Stories, op. cit., p. 109. « Le vent souffle », traduction d’Anne Mounic, in « Katherine Mansfield », Europe n° 1003-1004, novembre-décembre 2012, p. 78.
[5] « The Commissaire of Police stood on one side, a Nameless Official on the other. » Katherine Mansfield, « An Indiscreet Journey », in The Collected Stories, op. cit., p. 618.
[6] « He was an old man with a fat swollen face covered with big warts. Horn-rimmed spectacles squatted on his nose. » Ibid.
[7] « my sweetest early-morning smile », « But the delicate thing fluttered against the horn spectacles and fell. » Ibid.
[8] « the fatal name », ibid., p. 623.
[9] « there is an espèce de sea-gull couché sur votre chapeau », ibid., p. 622.
[10] « terrified », ibid., p. 623.
[11] « two colonels seated at two tables », ibid.
[12] « Sumptuous and omnipotent », ibid.
[13] « God I », « God II », ibid., pp. 623 et 624.
[14] « I had a terrible feeling, as I handed my passport and ticket, that a soldier would step forward and tell me to kneel. I would have knelt without question. » Ibid., p. 623.
[15] « Their heads rolled on their tight collars, like big over-ripe fruits. » Ibid.
[16] « N’a-t-on pas dit que, pendant la guerre, nous n’étions pas seulement à l’ennemi, mais encore ‘à l’ennui’ ? » Eugène Minkowski, Le Temps vécu(1933). Brionne : Gérard Monfort, 1988, p. 12.
[17] « Policemen are as thick as violets everywhere. » The Collected Stories, op. cit., p. 624.
[18] « the boss », « The Fly », in ibid., p. 412.
[19] « old Woodifield », ibid., p. 413.
[20] « Nice broad paths. » Ibid., p 414.
[21] « It had been a terrible shock to him when old Woodifield sprang that remark upon him about the boy’s grave. It was exactly as though the earth had opened and he had seen the boy lying there with Woodifield’s girls staring down at him. For it was strange. Although over six years had passed away, the boss never thought of the boy except as lying unchanged, unblemished in his uniform, asleep for ever. ‘My son !’ groaned the boss. » Ibid., p. 415.
[22] « The boy had never looked like that. » Ibid., p. 416.
[23] W.B. Yeats, Préface à : The Oxford Book of Modern Verse. Oxford: Clarendon, 1936, pp. XXXIV-XXXV. Cité par Jon Silkin dans Out of Battle : The Poetry of the Great War (1972). Second Edition. London: Macmillan, 1998, p. 177.
[24] « an idea », « the brilliant notion », in The Collected Stories, op. cit., p. 417.
[25] « Over and under, over and under, went a leg along a wing as the stone goes over and under the scythe. » Ibid.
[26] « admiration for the fly’s courage », ibid.
[27] « And while the old dog padded away he fell to wondering what it was he had been thinking about before. What was it ? It was… He took out his handkerchief and passed it inside his collar. For the life of him he could not remember. » Ibid., p. 418.
[28] Rachel Bespaloff, De l’Iliade (1943). Paris : Allia, 2004, p. 77.
[29] Ibid.
[30] « ‘Excuse me, Mademoiselle, you dropped this.’ And he handed her an egg. » « Feuille d’Album », in The Collected Stories, op. cit., p. 166.
[31] « « a petit soldat, all boots and bayonet. Forlorn and desolate he looked, like a little comic picture waiting for the joke to be written underneath », ibid., p. 619.
[32] « Your soldiers are stamped upon your bosom like bright irreverent transfers. » Ibid., p. 620.
[33] « as a baby peers out of his pram », ibid., p. 412.
[34] « dodged in and out of his cubby-hole like a dog that expects to be taken out for a run », ibid., p. 415.
[35] « They are bunches of ribbons tied on to the soldiers’ graves. » Ibid., p. 619.
[36] « have battles been fought in places like these ? » Ibid.
[37] « Time is the mercy of Eternity ». William Blake, Milton (1804-1808), in Complete Writings. Edited by Geoffrey Keynes. Oxford: Oxford University Press, 1989, p. 510.
[38] « To o’erthrow law ». William Shakespeare, The Winter’s Tale (1611, IV, 1, l. 8. Edited by Stephen Orgel. Oxford : O.U.P., 1998, p. 159.
[39] « And so from hour to hour we ripe and ripe,
And then from hour to hour we rot and rot;
And thereby hangs a tale. »
William Shakespeare, As You Like It (1600), II, 7, ll. 26-28. Edited by Alan Brissenden. Oxford : O.U.P., 1998, p. 144. Ma traduction ainsi que toutes les traductions de l’anglais dans cet essai.
[40] « Job est béni et il a tout reçu au double. ‒ Cela s’appelle une reprise. » Sören Kierkegaard, La Reprise. Edition de Nelly Viallaneix. Paris : GF-Flammarion, 1990, p. 156.
[41] « another ‘debt of love’ ». Katherine Mansfield, Notebooks, Volume 2. Edited by Margaret Scott. Minneapolis : University of Minessota Press, 2002, p. 32.
[42] Ibid., p. 33.
[43] « And she seemed to see on her eyelids the lovely pear tree with its wide open blossoms as a symbol of her own life. » Katherine Mansfield, « Bliss » (February 1918), in The Collected Stories, op. cit., p. 96.
[44] « They stretched in never-ending line ». William Wordsworth, « I wandered lonely as a cloud », in The Poems, Volume One. Edited by John O. Hayden. Harmondsworth : Penguin, 1977, p. 619.
[45] « When I read a play of Shakespeare I want to be able to place it in relation to what came before & what comes after. » Katherine Mansfield, Notebooks, Volume 2, op. cit., p. 30.
[46] « She is like St. Anne. » Katherine Mansfield, « An Indiscreet Journey », in The Collected Stories, op. cit., p. 617.
[47] Katherine Mansfield, « The Doves’ Nest », in ibid., p. 440.
[48] « Lions have been faced in a Burberry. » Ibid., p. 617.
[49] « He looked as though he had escaped from some holy picture, and was entreating the soldiers’ pardon for being there at all… » Ibid., p. 621.
[50] « what ladies love to call a heavy Egyptian cigarette », ibid., p. 623.
[51] « a family party having supper in the New Testament », ibid., p. 632.
[52] « a bayonet », ibid., p. 620.
[53] « a pair of forceps », ibid., p. 618.
[54] « the very last day of all », ibid., p. 627.
[55] William Shakespeare, King Lear (1604-1605), IV, 1, ll. 36-37. Edited by Kenneth Muir. London : Methuen, 1982, p. 140.
[56] Plaute, Théâtre complet, I. Edition de Pierre Grimal. Paris : Gallimard Folio Classique, 2007, p. 216.
[57] William Shakespeare, King Lear, V, 3, ll. 11-14, op. cit., p. 187.
[58] Lucien de Samosate, « Eloge de la mouche », in Œuvres complètes. Traduction d’Emile Chambry révisée et annotée par Alain Billault et Emeline Marquis. Paris : Laffont Bouquins, 2015, pp. 64-65.
[59] Homère, L’Iliade. Chant XVII, 570-572. Edition de E. Lasserre. Paris : Garnier-Flammarion, 1965, p. 300.
[60] « renew ». Katherine Mansfield, Notebooks, Volume 2, op. cit., p. 32.
[61] Lucien de Samosate, « Eloge de la mouche », in Œuvres complètes, op. cit., p. 65.
[62] « If thought is life, / And strength & breath ». William Blake, « The Fly », in Complete Writings, op. cit., p. 213.
[63] Katherine Mansfield, « An Indiscreet Journey », in The Collected Stories, op. cit., p. 617.
[64] Katherine Mansfield, « The Fly », in ibid., p. 417.
[65] “I hated writing it.” The Collected Letters of Katherine Mansfeld, Volume 5, 1922-1923, op. cit., p. 206.
[66] Katherine Mansfeild, « The Fly », in The Collected Stories, op. cit., p. 418.
[67] « … but how are we going to convey these overtones, half tones, quarter tones, these hesitations, doubts, beginnings, il we go at them directly ? It is most devilishly difficult, but I do believe that there is a way of doing it and thats by trying to get as near to the exact truth as possible. » Ibid., p. 214.
[68] Sur ce poète, voir Monde terrible où naître, op. cit., chapitre 9, pp. 366-375.
[69] Collected Poems. Edited by Patrick McGuinness. Manchester: Carcanet, 2005, p. 8.
[70] Voir pour de plus amples développements : Monde terrible où naître : La voix singulière face à l’Histoire, op. cit.
[71] « It seems to me that in life as it is lived today the catastrophe is imminent ; I feel this catastrophe in me. I want to be prepared for it, at least. »The Collected Letters of Katherine Mansfeld, Volume 5, 1922-1923, op. cit., p. 304.
[72] « All this sounds much too serious and dramatic. As a matter of fact there is absolutely no tragedy in it, of course. » Ibid.
[73] « Up already and walking in the fields, rosy from the rivers and the red-fringed pools, the sun lighted upon the swinging train and stroked my muff and told me to take off that Burberry. » Katherine Mansfield, « An Indiscreet Journey », in The Collected Stories, op. cit., p. 618.
[74] « sovereign eye ». William Shakespeare, Sonnet 33, in Sonnets. Edited by Stanley Wells. Oxford : O.U.P., 1987, p. 47.
[75] Voir à ce sujet : Ah, What Is It ? ‒ That I Heard : Katherine Mansfield’s Wings of Wonder, op. cit., Chapter 5, pp. 89-90.
Anne Mounic (1955-2022) a été poète, romancière, critique littéraire, traductrice, peintre et graveur. Elle a cofondé la revue Temporel et a enseigné à l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3).
 Hanns Lipps et la chouette Rébecca.
Hanns Lipps et la chouette Rébecca. Soldats allemands en transport vers la France en 1914. Le wagon de marchandises est décoré de slogans légers qui laissent présager une guerre brève.
Soldats allemands en transport vers la France en 1914. Le wagon de marchandises est décoré de slogans légers qui laissent présager une guerre brève.  Edith Stein dans un lazaret en Moravie dans le cadre d’une fête. Edith Stein Archiv Köln.
Edith Stein dans un lazaret en Moravie dans le cadre d’une fête. Edith Stein Archiv Köln.
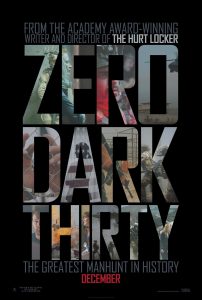 Zero Dark Thirthy (2012), US Poster, private collection.
Zero Dark Thirthy (2012), US Poster, private collection. Sicario (2015), US poster, private collection.
Sicario (2015), US poster, private collection.
