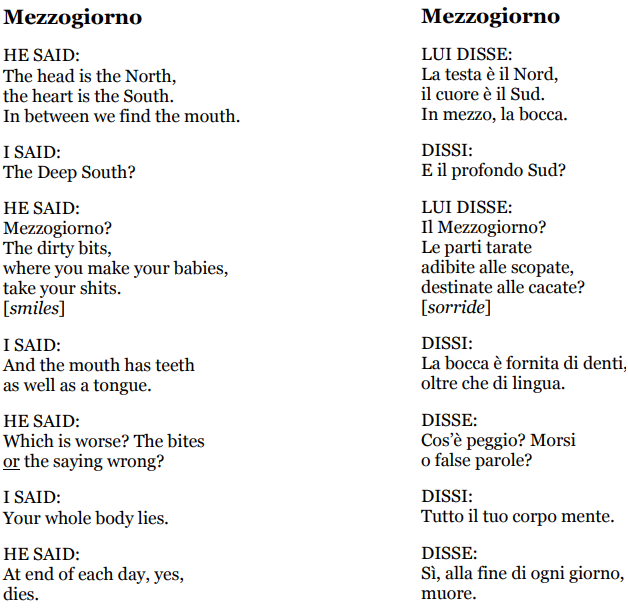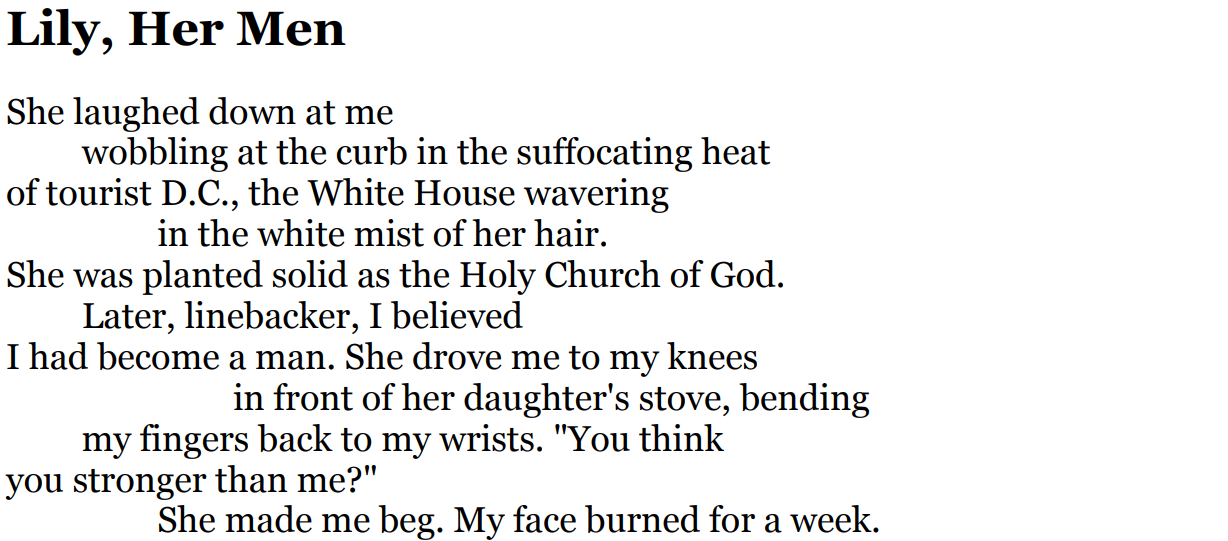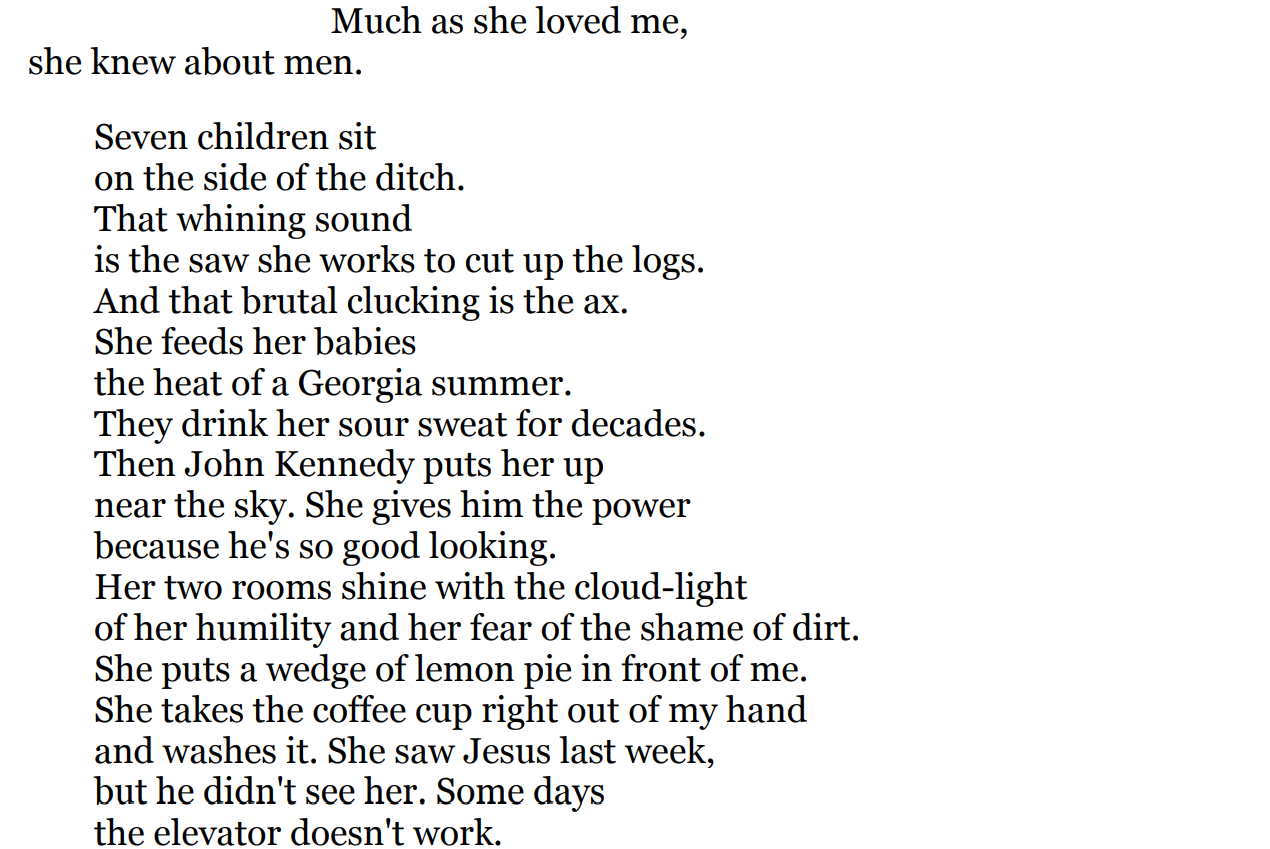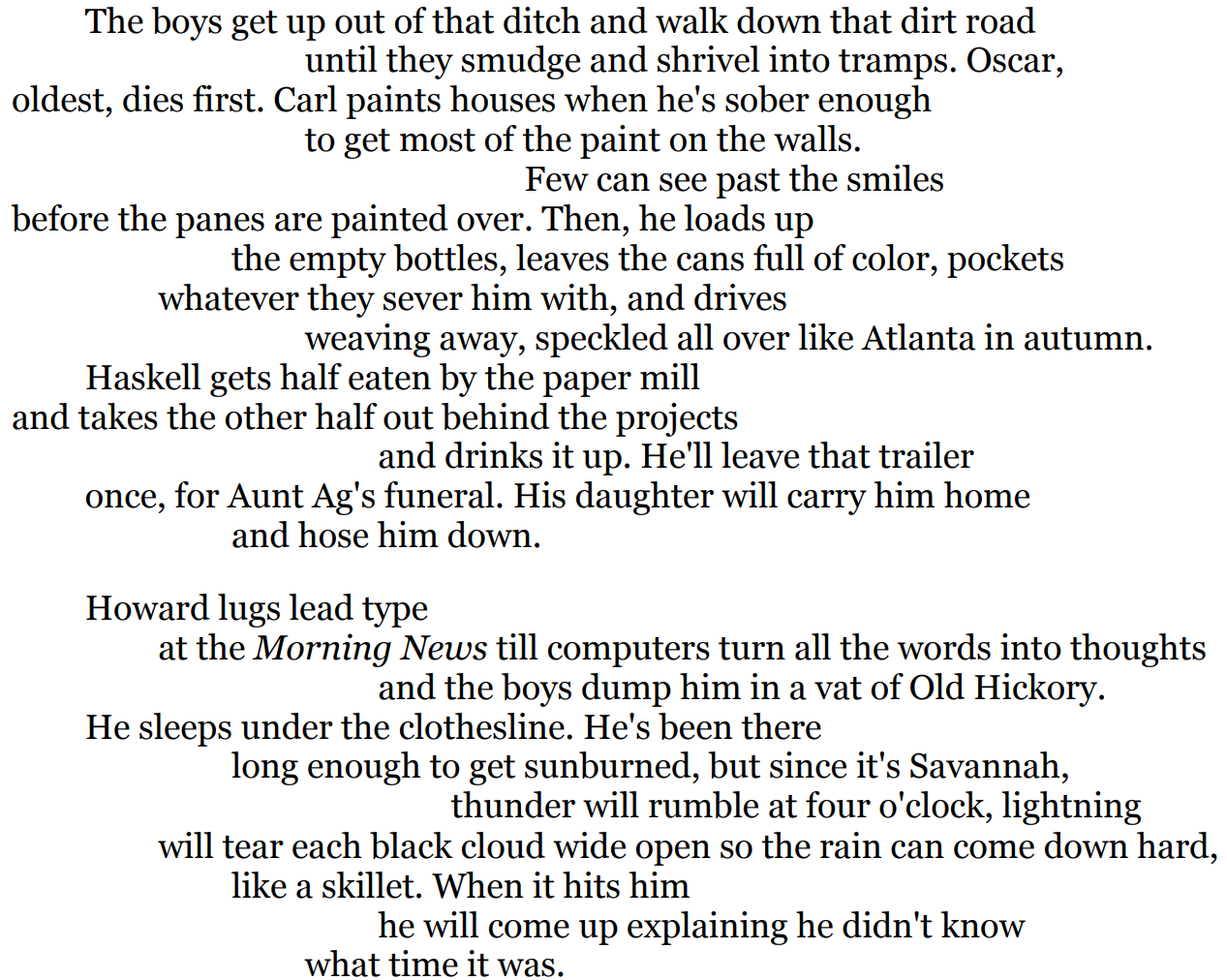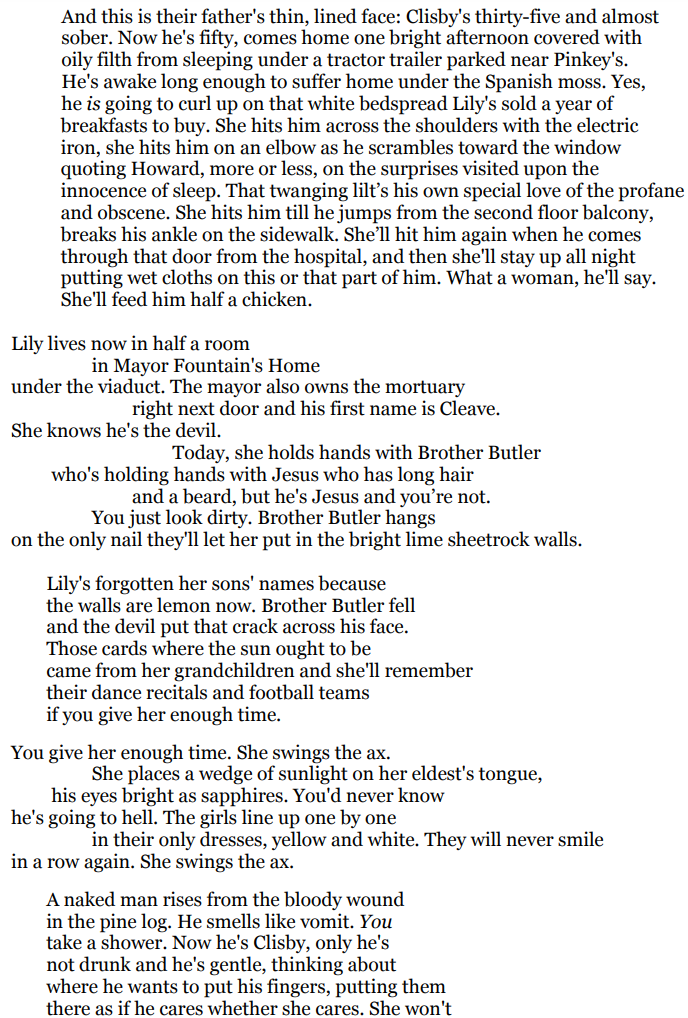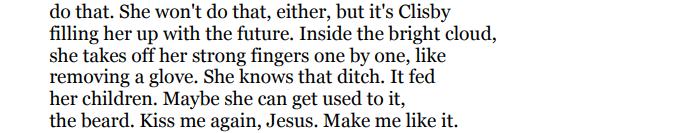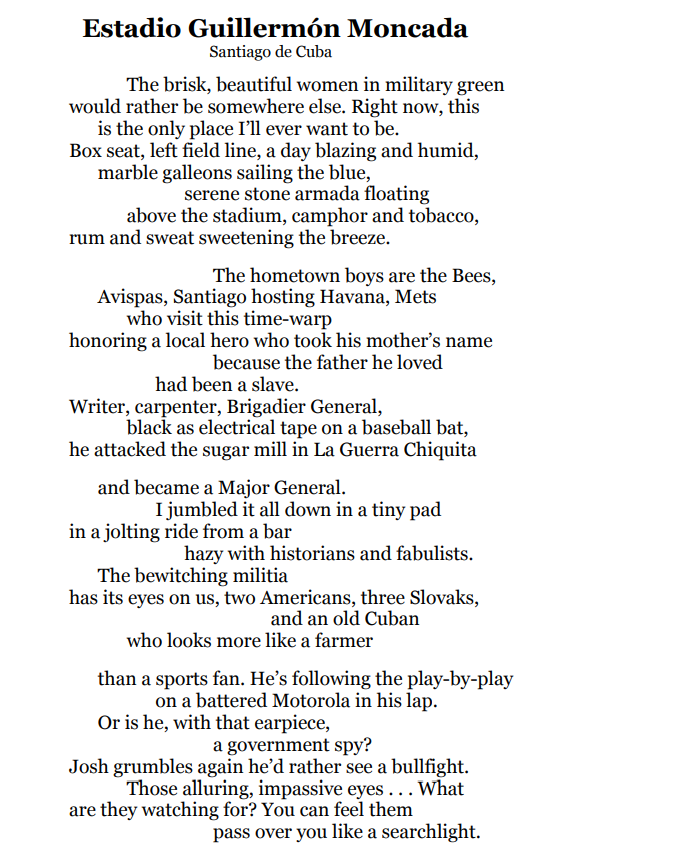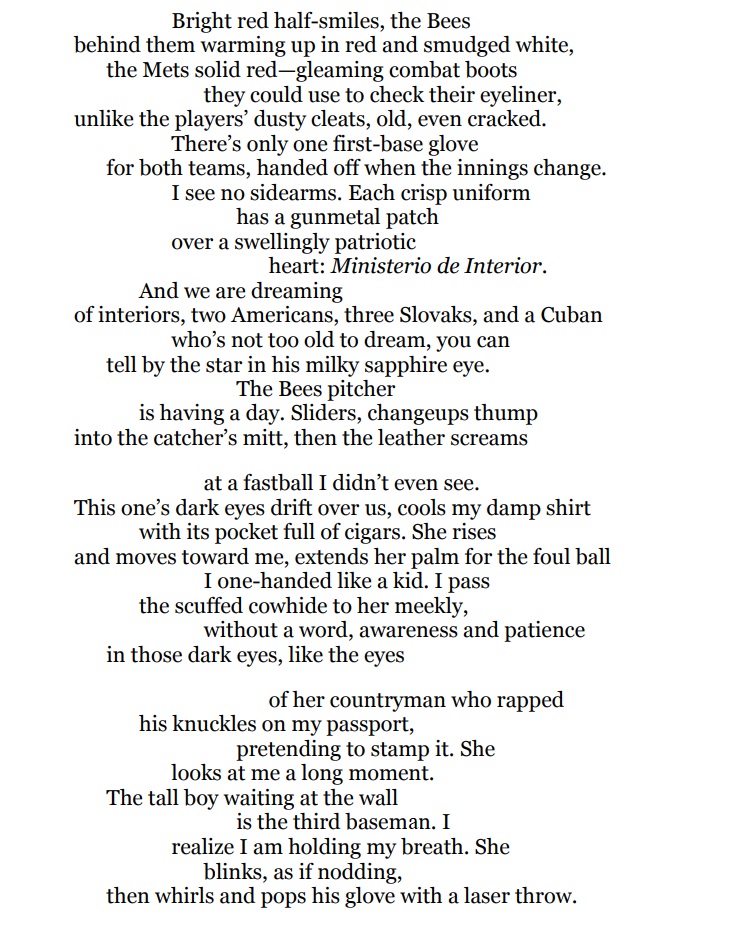MONIQUE LOJKINE-MORELEC
Pourquoi une nouvelle traduction du Waste Land de T.S.Eliot, alors qu’il en existe déjà plusieurs ? La première à être mentionnée dans la Bibliographie de Donald Gallup est celle de Jean de Menasce mais c’est surtout celle de Pierre Leyris qui fit connaître le poème en France et, probablement pour des raisons de copyright qui rendent difficile en France la publication de toute nouvelle traduction de ce texte, c’est elle encore qui a été choisie pour la récente édition de l’Anthologie bilingue de la poésie anglaise de la Pléiade. Or cette traduction fut publiée dès 1945, alors que le poème restait encore tout entouré de mystère et que le poète lui-même avait, à ce qui sera désormais son accoutumée, dressé l’écran d’une pseudo-interprétation du texte renvoyant à l’anthropologie frazérienne, en occultant les origines véritables, à la fois dans une vie personnelle tourmentée revisitée, ou peut-être même vécue, à travers les images et les mots constituant son bagage littéraire, philosophique et religieux et dans sa découverte de ce qui s’écrivait de plus novateur chez ses contemporains (à commencer par Joyce).
On ne saurait certes tenir rigueur à Leyris de s’en être tenu à ce qu’il avait sous les yeux ou lui reprocher de n’avoir pas su anticiper sur plus d’un demi-siècle de recherches universitaires. Mais on comprendra aisément que si sa traduction s’inscrit incontestablement dans l’histoire de la littérature, et si elle restera probablement encore longtemps la référence pour un public cultivé, elle ne répond plus aux besoins des chercheurs et des étudiants.
Le texte en est souvent beau, trop beau peut-être parfois, car c’est un travail de poète, une récriture qui, comme celle que fit l’abbé Prévôt de la Clarissa de Richardson, en permit une première appréhension par un public qui ne maîtrisait guère l’anglais et qui, sans cette aide ô combien précieuse, eût jugé le texte parfaitement incompréhensible. La beauté de la langue de Leyris fit saisir l’émotion que dégage le poème ; elle sut en rendre la pluralité des voix, en saisir la qualité musicale, tout à la fois empreinte de la tradition de la poésie anglaise telle qu’on pouvait la suivre à travers ce grand classique qu’était l’Oxford Book of English Verse et parcourue de grandes déchirures stravinskiennes qui en disaient la modernité. Mais toute belle traduction porte aussi la double marque de son auteur et de son temps et celle de Leyris n’échappe pas à un goût, certes mallarméen, de la belle langue, mais qui tend à purifier le langage de la tribu en quelque sorte par le haut, alors que l’entreprise d’Eliot, et surtout de Pound, au moment où fut mis en forme le poème était de le purifier à la manière laforguienne, voire verlainienne, à la fois lyrique comme le second et pleine d’ironie comme le premier, mais toujours dépouillée de toute ornementation pouvant rappeler cette fameuse « poetic diction » qu’avait déjà récusée Wordsworth.
Si en effet la poésie d’Eliot n’est pas d’un abord facile, ce n’est jamais en raison d’un vocabulaire excessivement recherché ni de l’usage répété de structures inversées, ni encore d’une accumulation d’adjectifs ; là où Eliot s’était laissé aller à de telles facilités, par un certain goût pour le vers rimé, Pound fut impitoyable dans ses suggestions de coupures drastiques, sacrifiant toute afféterie à la vigueur d’un vocabulaire simple et direct. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cette simplicité des mots ne soit pas un leurre car, chez Eliot, l’ambiguïté est partout à l’œuvre et c’est là que commencent les problèmes du traducteur. Les mots du poète doivent en effet être « entendus » dans plusieurs des sens du mot entendre simultanément mis en œuvre, leur sens immédiat, leurs connotations souvent, mais pas seulement, d’ordre littéraire (comme dans le cas de « carbuncular » ou de « jug jug »), leurs relations avec d’autres occurrences dans le texte (comme pour les mots « fear » ou « know »), leur sonorité, les glissements de sens suggestifs entre homophones (comme entre « game » et « gammon »), ou selon le registre (sens propre et sens figuré de « dirty ears » par exemple). Il faut aussi tenir compte des rythmes, liés à la longueur des mots, à leur qualité sonore, permettant la rime ou l’assonance. Les notes permettront, je l’espère, d’élucider mes choix là où ils furent difficiles et de signaler les pertes là où elles m’ont semblé inéluctables.
Le danger de la multiplication des notes est d’étouffer le texte. Eliot avait lui-même, assez vite, adjoint des notes à son poème; son ami John Hayward en avait ajouté quelques autres pour l’édition bilingue de Pierre Leyris. Il m’a fallu faire des choix car j’avais, moi aussi beaucoup de notes à ajouter. Des notes du poète je n’ai repris que les références à d’autres textes ; j’y ai ajouté la traduction des textes en langue étrangère ; en revanche je me suis contentée de résumer la note liminaire sur Frazer et Jessie Weston ainsi que la longue citation des Métamorphoses d’Ovide. J’ai omis les notes de John Hayward et j’ai limité les miennes à quelques références à Joyce, le grand « oublié » et à divers problèmes de traduction. J’ai laissé de côté toute référence d’ordre biographique, hormis le séjour à Lausanne, bien qu’elles soient essentielles à une complète compréhension de la charge émotionnelle du poème. Je n’ai pas non plus repris de manière exhaustive (si tant est que cela soit possible) toutes les références littéraires qui ont été suggérées par les critiques au fil des années.
Au centre des prédictions de Madame Sosostris le poète à placé une carte laissée en blanc que même le Surmoi, semble-t-il, s’interdit de voir ; elle pèse sur le dos du Marchand borgne comme ses péchés sur le dos de Christian, le héros de Bunyan parti à la recherche du salut, mais peut-être aussi comme la croix sur le dos de l’introuvable Pendu (Judas ? ou Jésus ?) Ce texte est et doit rester ambigu ; ce blanc restera son mystère.
TERRE EN DESHÉRENCE [1]
1922
‘Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent : Σίβυλλα τί θέλεις ; respondebat illa : ἀποθανεῖν θέλω.’ [2]
à Ezra Pound
il miglior fabbro. [3]
I. L’enterrement des morts
Avril est le mois le plus cruel, il enfante
Des lilas dans la terre morte, mêlant
Mémoire et désir, ranimant
Des racines engourdies de ses pluies printanières.
L’hiver nous tenait au chaud, [4] recouvrant
La terre d’une neige d’oubli, nourrissant
Un reste de vie de tubercules séchés.
L’été nous surprit sur le Starnbergesee [5]
Quand survint une averse ; nous fîmes halte sous les arcades
Pour repartir sous le soleil vers le Hofgarten
Prendre un café et passer une heure à papoter.
Bin gar keine Russin, stamm’aus Litauen, echt deutsch. [6]
Et quand nous étions enfants, en visite chez l’archiduc
Mon cousin, il m’emmena sur un traîneau
Et j’eus très peur. Il me dit
Marie, tiens bon ! Et à nous la descente !
En montagne, c’est là qu’on se sent libre.
Je lis presque toute la nuit et, l’hiver, je pars pour le sud.
Quelles sont ces racines qui s’agrippent, quelles branches sortent
De ces détritus plein de cailloux ? Fils de l’homme [7]
Tu ne peux le dire ni le deviner, car tu ne connais rien d’autre
Qu’un fatras d’images brisées, là où frappe le soleil,
Où l’arbre mort n’offre pas d’abri, la sauterelle pas de répit, [8]
Et la pierre sèche pas de bruit d’eau. De l’ombre
Il n’ y en a que sous ce rocher rouge
(Viens te mettre à l’ombre de ce rocher rouge)
Et je te montrerai quelque chose qui n’est ni
Ton ombre qui au matin te suit à grands pas
Ni ton ombre qui au soir se dresse à ta rencontre ;
Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière.
Der Heimat zu
Frisch weht der Wind
Mein Irisch Kind,
Wo weilest du [9]
« La première fois que tu m’as donné des jacinthes, c’était l’an passé;
Tous m’appelaient la fille aux jacinthes. » [10]
Pourtant à notre retour, au soir, du jardin des jacinthes,
Toi les bras chargés de fleurs, et les cheveux mouillés [11], moi
Je restai sans voix et la vue me manqua,
Ni mort ni vif, je ne reconnus rien, [12]
Les yeux au coeur de la lumière, du silence.
Oed’ und leer das Meer. [13]
Madame Sosostris, [14] voyante renommée,
Avait un mauvais rhume ; mais
Elle passe néanmoins pour la femme la plus habile d’Europe
A faire parler un jeu de cartes de malheur. [15] Voici, dit-elle,
Votre carte, le marin Phénicien noyé,
(Voilà des perles, c’étaient ses yeux. [16] Regardez !)
Voici Belladonna, la Dame aux Rochers, [17]
La dame des conjonctures difficiles.
Voici l’homme aux trois bâtons, et voici la Roue,
Et voici le marchand qui n’a qu’un œil, et cette carte
Laissée en blanc, c’est une chose qu’il porte sur le dos,
Mais qu’il m’est interdit de voir. Je ne trouve pas
Le Pendu. Redoutez la mort par l’eau.
Je vois des foules de gens qui tournent en rond.
Merci. Si vous voyez cette chère Madame Equiton
Dites-lui que j’apporterai l’horoscope moi-même :
Il faut tellement se méfier de nos jours .
Irréelle cité, [18]
Dans le brouillard rougeâtre d’une aube hivernale,
Une foule déferlait sur le Pont de Londres, ils étaient tant…
Je n’aurais pas cru que la mort en eût défait tant. [19]
Des soupirs, brefs et espacés, s’en exhalaient [20]
Et chacun avait les yeux fixés sur ses pieds.
Le flot montait la côte puis dévalait King William Street,
Jusqu’à Saint Mary Woolnoth qui tenait le compte des heures,
Avec une note sombre au dernier coup de neuf heures.
C’est là que je vis une vieille connaissance et l’arrêtai en criant: [«Stetson !
Toi qui étais avec moi sur les navires, au large de Myles ! [21]
Ce cadavre que tu as planté dans ton jardin l’an dernier,
Sort-il déjà de terre ? Va-t-il fleurir cette année ? [22]
Ou la gelée soudaine a-t-elle dérangé sa couche?
Oh éloigne d’ici le chien, qui est l’ami de l’homme, [23]
Ou de ses griffes il va encore le déterrer !
« Hypocrite lecteur ! — mon semblable, — mon frère ! » [24]
II. Une partie d’échecs [25]
Le siège sur lequel elle était assise, tel un trône aux ors brunis, [26]
Rougeoyait sur le marbre, là où le miroir
Aux montants ouvragés de pampres chargés de fruits
D’où l’épiait à la dérobée un Cupidon doré
(Un autre se cachait les yeux sous une aile)
Renvoyait les flammes de candélabres à sept branches
Réfléchissant la lumière sur la table tandis
Que montait vers elle le scintillement de ses bijoux,
Hors des écrins satinés répandus à riche profusion.
Dans l’ivoire et le verre coloré de flacons
Restés ouverts, étaient tapis ses étranges parfums synthétiques— [27]
Onguents, poudres, ou liquides, ils troublaient, brouillaient
Et noyaient les sens dans les odeurs ; avivés par l’air
Qui venait de la fenêtre, ils s’élevaient,
Epaississant la longue flamme des bougies,
Et projetaient leur fumée dans les laquearia, [28]
Donnant vie au décor du plafond à caissons.
D’énormes madriers tout cloutés de cuivre rejetés par la mer
Brûlaient vert et orange, encadrés par la pierre colorée,
Et dans cette lumière triste nageait un dauphin sculpté.
Au dessus de l’antique manteau de la cheminée était encadrée
Comme par une fenêtre s’ouvrant sur la scène sylvestre, [29]
La métamorphose de Philomèle, [30] par le roi barbare
Si brutalement forcée ; là pourtant le rossignol
Emplissait tout le désert d’une voix inviolable
Et toujours elle criait, et toujours court le monde,
« Et yo ! et yo ! » [31] pour des oreilles malpropres.
Et d’autres moignons flétris du temps
Etaient figurés sur les murs ; des silhouettes aux yeux fixes
Se penchaient, s’inclinant pour faire silence dans la pièce enclose.
Des pas traînaient dans l’escalier.
A la lueur du feu, sous la brosse, sa chevelure
Se déployait en pointes flamboyantes
S’embrasait en paroles, puis retombait en un silence sauvage.
« J’ai les nerfs à vif ce soir. Oui, à vif. Reste près de moi.
« Parle-moi. Pourquoi ne parles-tu jamais. Parle.
« A quoi penses-tu ? à quoi, dis… à quoi ?
« Je ne sais jamais ce que tu penses. Tu penses. »
Je pense que nous sommes dans la venelle aux rats
Là où les morts ont perdu leurs ossements.
« Quel est ce bruit ? »
Le vent sous la porte. [32]
« Et ce bruit maintenant ? Que fait donc le vent ?»
Rien, toujours rien.
« Rien vraiment,
Tu ne reconnais rien ? Tu ne vois rien ? Tu ne te rappelles
Rien ? »
Je me rappelle,
Voilà des perles, c’étaient ses yeux.
« Es-tu vivant, ou bien es-tu mort ? N’as-tu rien dans la tête ? »
Mais
ah-ah-ah ce fragment syncopé [33] de Shakespea-heare
C’est si élégant
Si intelligent
« Qu’est-ce que je vais faire maintenant ? Qu’est-ce que je vais faire ?Je vais me précipiter dehors telle que je suis et arpenter les trottoirs
Les cheveux défaits, voilà. Qu’allons-nous faire demain ?
Qu’allons-nous jamais faire? »
L’eau chaude à dix heures.
Et s’il pleut, une voiture fermée à quatre heures.
Et puis nous ferons une partie d’échecs, [34]
Pressant des yeux sans paupières en attendant qu’on frappe à la [porte.
Quand l’ mari d’ Lil est rev’nu d’la guerre, j’y ai dit [35]
—et j’ai pas mâché mes mots — j’y ai dit moi-même,
PRESSONS, PRESSONS, ON FERME
V’là Albert qui r’vient, arrange-toi un peu.
I voudra savoir c’que t’as fait des sous qu’i t’a donnés
Pour t’ refaire les dents. I t’en a donné, j’étais là.
Faut tout arracher, Lil, et t’payer un beau dentier ;
J’te jure qu’il a dit, j’peux plus supporter d’ te r’garder.
Et moi non plus, qu’j’ai dit ; et pense à ç’pauv’ Albert,
Ca fait quatre ans qu’ est à l’armée, i voudra s’prendre du bon temps,
Et si c’est pas toi qui y’en donne, y’en aura d’aut’ pour l’ faire, que j’y [ai dit.
Alors, c’est comme ça ! qu’elle a dit. A peu près, que j’y ai dit.
Alors j’saurai qui r’mercier, qu’elle m’a dit et elle m’a r ‘gardée droit [dans les yeux.
PRESSONS, PRESSONS, ON FERME
Si ça t’plaît pas, c’est tout comme, que j’y ai dit.
Y en a d’aut’ qui savent y faire, si toi tu sais pas.
Mais si Albert s’fait la malle, t’auras été prév’nue.
T’as pas honte, que j’y ai dit, t’as l’air d’une ruine
(elle a même pas trente-deux ans)
J’y peux rien, qu’elle a dit, en f’sant la gueule,
C’est les cachets qu’j’ai pris, pour l’faire passer, qu’elle a dit.
(Elle en a d’jà cinq, et pour le p’tit Georges elle a bien failli y rester.)
L’pharmacien l’ a dit qu’ça irait, mais j’suis pus comme avant.
T’es vraiment trop gourde, qu’ j’y ai dit.
Et pis si Albert veut pas t’fout’ la paix, t’y peux rien, qu’j’y ai dit,
Pourquoi tu t’es mariée si tu veux pas d’moufflets?
PRESSONS, PRESSONS, ON FERME
Bon, ç’dimanche qu’Albert est rev’nu, i z’ont fait un cuissot d’cochon,
Et i’ m’ont dit d’venir manger, pour l’savourer tout chaud —
PRESSONS, PRESSONS, ON FERME
PRESSONS, PRESSONS, ON FERME
Bonsoir Bill. Bonsoir Lou. Bonsoir May. Bonsoir.
Merci merci Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, belles dames, bonsoir gentes dames, bonsoir, bonsoir. [36]
III Le Sermon sur le feu
Le dais du fleuve s’est brisé : les derniers doigts de feuille
S’agrippent à la berge humide et sont engloutis. Le vent
Parcourt la terre brune, et personne pour l’entendre. Les nymphes [s’en sont allées.
Douce Tamise, coule en silence, tout au long de mon chant. [37]
Le fleuve n’emporte ni bouteilles vides, ni papiers gras;
Ni mouchoirs de soie, cartons ou mégots,
Ou autres souvenirs des nuits d’été. Les nymphes s’en sont allées.
Et leurs petits amis, héritiers désoeuvrés des potentats de la City,
En allés eux aussi, sans laisser d’adresse.
Près des eaux du Léman [38] je me suis assis pour pleurer …
Douce Tamise, coule en silence, tout au long de mon chant.
Douce Tamise, coule en silence, car je ne parlerai ni fort ni
[longtemps.
Mais derrière moi dans un souffle glacé j’entends [39]
Le cliquetis des ossements qui s’entrechoquent et ricanent de toutes [leurs dents.
Un rat s’est glissé, furtif parmi les herbes
Traînant son ventre visqueux sur la berge
Tandis que je pêchais dans les eaux ternes du canal
Là-bas derrière l’usine à gaz un soir d’hiver
Songeant au naufrage du roi mon frère
Et à la mort de mon père avant lui.
Corps blancs, nus sur la terre humide en contrebas
Ossements jetés dans une soupente sèche en contrebas,
Que seule la patte du rat fait cliqueter, d’année en année.
Mais de temps en temps derrière moi j’entends [40]
Le son des trompes et des moteurs qui, au printemps,
Conduiront Sweeney [41] chez Mrs Porter
Oh la lune d’un vif éclat brille
Sur Mrs Porter et sur sa fille
Elles se lavent les pieds dans l’eau qui pétille [42]
Et O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole ! [43]
Twit twit twit
Tio tio tio tio tio
Si brutalement forcée.
Térée
Cité irréelle
Sous le brouillard rougeâtre d’un midi d’hiver
Mr. Eugenidès, le marchand de Smyrne
Mal rasé, la poche pleine de raisins secs,
C.A.F.[44], Londres, effets à vue,
M’invita en français démotique
A un déjeuner au Cannon Street Hotel
Suivi d’un weekend au Metropole.
A l’heure violette, où les yeux et le dos
Se lèvent du bureau, où la machine humaine attend
Frémissante comme un taxi qui attend,
Moi Tirésias,[45] bien qu’aveugle, palpitant entre deux vies,
Vieil homme aux mamelles ridées, je vois
A l’heure violette, l’heure vespérale qui chemine à grand peine
Vers sa demeure, et ramène chez lui le marin de la mer,
La dactylo chez elle à l’heure du thé, débarrasse les reliefs du matin, [allume
Son poële et dispose des conserves sur la table.
A grand péril suspendues à sa fenêtre sèchent
Ses combinaisons qu’effleurent les derniers rayons du soleil,
Sur le divan (sa couche le soir venu) sont empilés
Bas, pantoufles, cache-corsets et corset.
Moi Tirésias, vieil homme aux mamelles ridées,
Ne manquai pas de percevoir la scène et d’en prédire la suite —
Moi aussi je guettai le visiteur attendu.
Visage en feu, il arrive, le boutonneux, [46]
Petit employé d’agence immobilière, au regard effronté,
De ce bas peuple à qui sied la hardiesse
Comme chapeau de soie à millionnaire de Bradford.
Le moment est propice, à ce qu’il pense,
Le repas est fini, elle s’ennuie, elle est lasse.
Il tente de l’entraîner dans des caresses ;
Sans le moindre désir, pourtant elle ne les repousse .
Plein de fougue, résolu, aussitôt à l’assaut il se lance ;
Ses mains baladeuses ne rencontrent aucune résistance ;
Sa fatuité, qui ne requiert nulle réponse
Se satisfait de simple indifférence.
(Et moi Tirésias j’ai déjà tout subi
Ce qui s’est joué sur cette même couche, ce même divan ;
Moi qui suis resté sous les murailles de Thèbes
Et qui ai marché tout au fond des Enfers parmi les morts.)
Il la gratifie d’un dernier baiser protecteur,
Et s’en va à tâtons, trouvant éteinte la lumière de l’escalier …
Elle se détourne et, un instant, se regarde dans la glace,
A peine consciente du départ de son amant ;
Son cerveau ne s’autorise qu’une pensée à peine esquissée :
« Ca y est, c’est fait, et tant mieux c’est fini ».
Lorsque femme exquise fait une sottise [47]
Et, une fois seule, arpente à nouveau sa chambre,
Elle lisse ses cheveux d’un geste machinal
Et place un disque sur le gramophone.
« Cette musique est passée, au ras de l’eau, tout près de moi » [48]
Et le long du Strand, en remontant Queen Victoria Street.
O Cité, cité, parfois j’entends
Près d’un bar public de Lower Thames Street,
La douce plainte d’une mandoline
Au milieu des bruits de voix et de vaisselle
Là où les marchands de poisson flânent à midi :
Là où les murs de Magnus Martyr [49] retiennent
L’inexplicable splendeur de l’or et de la blancheur ionienne.
Le fleuve sue [50]
Mazout et goudron
Les péniches dérivent dans le courant
Au changement de la marée
Voiles rouges
Largement déployées
Sous le vent, virent de bord sur le lourd espar.
Les péniches repoussent
Des rondins qui filent à la dérive
Par le bief de Greenwich
Au large de l’Ile aux Chiens.
Weialala leia
Wallala leialala
Elisabeth et Leicester [51]
Rames battant les flots
Poupe lovée
Comme conque dorée
Rouge et or
Une forte houle
Ondulait sur l’une et l’autre rive
Un vent de sud-ouest
Portait au fil de l’eau
Le carillon des cloches
Tours blanches
Weialala leia
Wallala leialala
« Trams et arbres poussiéreux.
Highbury m’a vue naître ; Richmond et Kew
M’ont défaite [52] ; passant Richmond j’ai levé les genoux,
Couchée tout au fond d’une étroite embarcation. »
« J’ai les pieds à Moorgate, et le cœur
Sous les pieds. Après la chose
Il a pleuré, promis « un nouveau départ. »
Moi je n’ai rien dit. De quoi lui en voudrais-je ? »
« Sur le sable de Margate.
Rien pour moi qui se rattache
A rien.
Des ongles cassés sur des mains sales.
Mes parents des gens simples qui ne s’attendent
A rien. »
la la
C’est alors que j’arrivai à Carthage [53]
Brûlant brûlant brûlant brûlant [54]
O Seigneur Tu m’arraches
O Seigneur Tu arraches [55]
brûlant
IV. La Mort par l’eau
Phlébas le Phénicien, mort depuis deux semaines,
Oubliait le cri des mouettes et les creux de la houle
Et les profits et les pertes.
Un courant sous-marin
Lui décapait les os en chuchotant. Tantôt à la crête et tantôt au creux [de la vague
Il remonta le fil des jours jusqu’à sa jeunesse
A l’entrée du tourbillon.
Juif ou gentil
O toi qui tiens la barre, le regard au vent,
Considère Phlébas, qui fut autrefois grand et beau comme toi . [56]
V. Ce que dit le tonnerre [57]
Après le rougeoiement des torches sur des visages en sueur
Après le silence glacé dans les jardins
Après la douleur parmi les pierres
Les cris et les pleurs
La prison et le palais et l’écho
Du tonnerre printanier au loin sur les montagnes
Celui qui était vivant est mort désormais
Et nous qui étions vivants nous allons mourir
Avec un peu de patience
Pas d’eau ici, mais seulement le roc
Le roc et pas d’eau et la route sableuse
La route qui monte en lacets dans les montagnes
Qui sont des montagnes de roc où il n’y a pas d’eau.
S’il y avait de l’eau nous ferions halte et nous boirions
Parmi les rocs on ne peut ni faire halte ni penser
La sueur est tarie et les pieds sont dans le sable
Si seulement il y avait de l’eau parmi les rocs
Bouche de montagne morte aux dents cariées impuissante à cracher
Ici l’on ne peut ni rester debout ni s’asseoir ni se coucher
Pas même le silence dans les montagnes
Mais un tonnerre sec et stérile sans pluie
Pas même la solitude dans les montagnes
Mais des visages rouges et hargneux qui ricanent et grondent
Sur le seuil de maisons au torchis craquelé
S’il y avait de l’eau
Et pas de roc
S’il y avait du roc
Et aussi de l’eau
Et de l’eau
Une source
Une vasque dans le roc
S’il y avait seulement le bruit de l’eau
Pas le chant de la cigale
Et de l’herbe sèche
Mais le bruit de l’eau sur un rocher
Là où la grive solitaire chante dans les pins
Flic floc flic floc floc floc floc floc
Mais il n’y a pas d’eau
Quel est ce troisième qui marche toujours auprès de toi ? [58]
Quand je compte il n’y a que toi et moi ensemble sur la route blanche
Mais quand je regarde là bas devant
Il y a toujours quelqu’un d’autre auprès de toi, qui glisse
Enveloppé d’un manteau brun, encapuchonné
Je ne sais pas si c’est un homme ou une femme
Mais qui est-ce donc qui marche près de toi de l’autre côté ?
Quel est ce bruit très haut dans l’air [59]
Murmure de lamentation maternelle
Qui sont ces hordes encapuchonnées qui fourmillent
Sur des plaines infinies, trébuchant dans la terre craquelée
Que rien n’encercle hormis le seul horizon plat
Quelle est la cité par delà les montagnes
Qui se craquèle se reforme et explose dans l’air violet
Tours qui s’écroulent
Jérusalem Athènes Alexandrie
Vienne Londres
Irréelles
Une femme étira ses longs cheveux noirs
Et joua une petite musique, à peine un murmure, sur ces cordes
Et des chauves-souris au visage de bébés dans la lumière violette
Sifflèrent en battant des ailes
Et se laissèrent glisser, tête première, au bas d’un mur noirci
Et, inversées dans l’air, il y avait des tours
Qui, gardiennes des heures, faisaient carillonner des cloches [réminiscentes,
Et des chants qui montaient de citernes vides et de puits asséchés.
Dans ce trou de carie parmi les montagnes
Dans la pâle clarté de la lune, l’herbe chante
Sur les tombes retournées, autour de la chapelle [60]
C’est là qu’est la chapelle vide, où n’habite que le vent.
Elle n’a pas de fenêtres, et la porte bat,
Des ossements secs ne peuvent faire de mal à personne.
Seul un coq se tenait sur la poutre maîtresse
Co co rico co co rico
Dans la fulgurance d’un éclair. Puis un coup de vent moite
Apportant la pluie
Ganga était au plus bas, et les feuilles flasques
Attendaient la pluie, tandis qu’au loin les nuages noirs
S’amassaient au dessus de l’Himavant.
La jungle faisait le gros dos, tapie en silence.
C’est alors que parla le tonnerre
Da [61]
Datta : Qu’avons-nous donné ?
Mon ami, le sang qui me secoua le coeur
L’audace épouvantable d’un instant d’abandon
Qu’une éternité de prudence ne saurait effacer
C’est par là, et par là seulement, que nous avons existé
Par cela qu’on ne peut trouver ni dans notre nécrologie
Ni dans les souvenirs que drape l’araignée bienveillante [62]
Ni sous les sceaux que brisera le notaire étriqué
Dans nos chambres vides
Da
Dayadhvam : j’ai entendu la clé [63]
Tourner dans la serrure une fois et une fois seulement
Nous pensons à la clé, chacun dans sa prison
En pensant à la clé, chacun confirme sa prison
Seulement à la nuit tombée des rumeurs ethérées
Redonnent un instant de vie à un Coriolan brisé [64]
Da
Damyata : le bateau répondait
Gaîment au maniement expert de la voile et de la rame
La mer était calme, ton cœur eût répondu
Gaîment à l’invite, battant docilement
Dans des mains tenant ferme le gouvernail.
Je pêchais assis sur la côte, [65]
La plaine aride derrière moi
Vais-je au moins mettre de l’ordre dans mes terres ?
C’est le Pont de Londres qui s’effondre, qui s’effondre [66]
Poi s’ascose nel foco che gli affina [67]
Quando fiam uti chelidon [68] — O hirondelle hirondelle
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie [69]
J’ai repêché ces fragments pour étayer mes ruines
Alors voilà, j’ai ce qu’il vous faut [70]. Hieronymo est redevenu fou.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih [71]
NOTES
(NP) à la fin d’une note signifie Note du Poète.
(NT) signifie Note de la Traductrice, lorsqu’il pouvait y avoir confusion.
[1] Le titre, « The Waste Land », fut repris par Eliot d’un poème de Madison Cawein, publié dans Poetry, à Chicago en 1913 alors que le manuscrit avait longtemps porté le titre, emprunté à un personnage de Dickens dans Our Mutual Friend : « He Do the Police in Different Voices » (« Il joue la police à plusieurs voix ») dont on retrouvera l’esprit dans la note concernant Tirésias (note 45). Il n’est pas inintéressant de garder à l’esprit cette idée d’une investigation à plusieurs voix, sans omettre le son et le rythme de ces « voix
d’acteur » en quelque sorte, toutes néanmoins issues d’un même locuteur sous différents masques.
Le poème a donné lieu à plusieurs traductions ; la première, celle de Jean de Menasce, fut publiée en 1926 avec la mention « revue et approuvée par l’auteur », d’abord sous le titre de « La Terre Mise à Nu » (Esprit I, mai 1926), puis sous le titre de « La Terre Gaste » dans Philosophies. La traduction la plus connue est néanmoins celle de Pierre Leyris, parue dans La Licorne I (printemps 1947) sous le titre de « La Terre Vaine » puis reprise par les éditions du Seuil et enfin, entrée en 2005 dans l’Anthologie bilingue de la poésie anglaise de la Pléiade. Des traductions plus récentes voient peu à peu le jour.
« Gaste » est un mot d’ancien français issu de la même racine que « waste », mais serait-il encore compris, hormis des érudits ? Quant à « vaine », il se rattache, par le latin, à l’autre terme, « vanus », vide, vain , en concurrence avec « vastus », inoccupé, désolé, qui a donné « dévasté » ; le mot est joli, mais il me semble tirer le texte un peu trop du côté de l’Ecclésiaste.
Le titre que j’ai choisi, pour ma part, joue un peu sur les mots, comme le fait d’ailleurs, bien que différemment, le mot anglais « waste ». « Waste » suggère en effet, par delà le sens d’un lieu stérile et désolé, aussi celui d’un gâchis ; « deshérence » quant à lui signifie l’absence d’héritier, ce qui peut aisément s’induire de la stérilité, mais à cela s’ajoutent les mots « désert » et « errance » que l’on peut entendre, toute étymologie oubliée, derrière ses quatre syllabes. Ce sera, je crois, le seul mot un peu recherché qu’à la différence de Leyris je me permettrai pour rendre un mot appartenant au vocabulaire commun qu’Eliot a systématiquement privilégié (à l’exception de « cabuncular » qu’en revanche je ne reprendrai pas ; voir note 46).
[2] « J’ai vu de mes propres yeux la Sybille de Cumes, suspendue dans une bouteille, et lorsque les enfants lui demandaient : « Sibylle que désires-tu » elle répondait : « je désire mourir. » cette épigraphe, tirée du Satyricon de Pétrone, fut substituée, assez tardivement, aux derniers mots de Kurtz, dans Heart of Darkness de Joseph Conrad que Pound considérait comme insuffisamment prestigieux : « Revit-il sa vie dans chaque détail de désir, de tentation et d’abandon dans ce moment suprême de connaissance absolue ? Une image, une vision, le fit s’écrier dans un murmure, par deux fois, un cri qui ne fut guère plus qu’un souffle, ‘L’horreur ! l’horreur !’ »
[3] C’est grâce aux nombreux va-et-vient des manuscrits entre le poète et lui que le poème prit sa forme définitive ; il suggéra de nombreuses coupes, non seulement l’omission de passages entiers, mais aussi un resserrement des textes conservés, éliminant tout ce qui ne lui semblait pas être le meilleur, même si cela devait donner parfois l’illusion qu’Eliot était un adepte du vers libre alors qu’une partie des textes était à l’origine d’écriture plutôt classique, d’où la subsistance de certains vers rimés (l’épisode de la dactylo et de son amant boutonneux était à l’origine écrit en quatrains rimés).
L’ensemble des manuscrits a été publié en 1971 par Mrs Valérie Eliot : T.S. Eliot The Waste Land a facsimile & transcript of the original drafts including the annotations of Ezra Pound, Faber & Faber, 1971.
[4] Eliot associe ici implicitement son « Enterrement des morts » à celui de Marcello par sa mère Cornelia dans The White Devil de Webster (voir note 22); mais on ne saurait oublier qu’Eliot avait eu entre les mains le manuscrit de plusieurs chapitres d’Ulysse de James Joyce ; j’attirerai donc , lorsque cela me semble pertinent, l’attention sur des échos le plus souvent méconnus, d’autant plus volontiers qu’Eliot lui-même prit en quelque sorte les devants en saluant , dans « Ulysses, Order, and Myth » (The Dial Nov. 1923), comme une véritable « découverte scientifique » l’invention par Joyce d’une « méthode mythique », fondée sur l’anthropologie frazérienne, sans toutefois reconnaître sa dette personnelle envers l’auteur d’Ulysse. (NT)
Dans la note liminaire qui introduit les notes qu’il adjoignit au poème lors de sa publication en plaquette, Eliot écrit en parallèle (bien que sans référence à Joyce) : « Non seulement le titre, mais le plan et, pour une bonne part, le symbolisme accidentel de ce poème ont été suggérés par le livre de Miss Jessie Weston sur la légende du Graal : From Ritual to Romance (Cambridge). Je lui dois tant, en vérité, que le livre de Miss Weston élucidera les difficultés du poème beaucoup mieux que mes notes ne sauraient le faire ; et je le recommande (indépendamment du grand intérêt qu’il présente par lui-même) à quiconque penserait que la dite élucidation en vaut la peine. Je suis également redevable, d’une manière générale, à un autre ouvrage d’anthropologie qui a profondément influencé notre génération : j’entends Le Rameau d’Or. J’ai mis particulièrement à contribution les deux volumes Adonis, Attis, Osiris. Tous ceux auxquels ces ouvrages sont familiers reconnaîtront immédiatement dans le poème certaines références aux rites de végétation. »
Tout cela s’applique en fait à la dernière phase de composition du poème et semble avoir servi d’écran, en quelque sorte curatif, à bien des angoisses personnelles qui sont néanmoins ce qui donne son authenticité au poème. On notera qu’aucune des trois voix prophétiques, celle de Madame Sosostris, interprétatrice du Tarot, celle de Tirésias, le devin grec et celle du Tonnerre des Upanishads de l’Inde, n’appartient à la légende du Graal et ne peut entrer en rapport avec elle que grâce à la fameuse « méthode mythique » attribuée à Joyce. (vide supra). (NT)
[5] La scène se situe à Munich où Eliot s’était rendu pour la première fois pendant l’été de 1911 et où il avait terminé la rédaction de « The Love Song of J.Alfred Prufrock » (« La Chanson d’amour de J. Alfred Prufrock »). (NT)
[6]« Je ne suis pas du tout Russe ; je viens de Lithuanie ; je suis une vraie Allemande »
[7] Le poète renvoie ici son lecteur à Ezechiel II, i (NP) où la voix de Dieu s’adresse à Ezechiel par ces mots pour en faire son prophète auprès d’une « nation rebelle » à la loi divine. (NT)
[8] Cf. Ecclesiaste XII, 5. (NP)
[9] V. Tristan und Isolde, I, vers 5-8. (NP)
[10] Le contexte ne permet pas de savoir si le poète songeait plutôt à une enfant (une fillette) ou à une jeune fille, d’où ma traduction par le seul mot de « fille »; je pencherais plutôt pour une toute jeune fille, à la limite entre ces deux états, en raison de l’association de ce passage avec d’autres textes, d’abord Tristan und Isolde dont deux citations encadrent le passage, mais aussi La Vita Nuova de Dante où le poète n’a que neuf ans lors de la rencontre avec Béatrice et « Dans le Restaurant », poème en français qu’Eliot publia dans The Little Review, V, 5 en Sept. 1918 où le protagoniste enfant a offert des primevères à une petite fille, sous une averse : « J’avais sept ans, elle était plus petite. / Elle était toute mouillée, je lui ai donné des primevères ». Dans ce même poème apparaîssent aussi un chien trouble-fête, comme à la fin de cette section, et un garçon de café au crâne peu ragoûtant et à l’esprit graveleux qui semble préfigurer les « oreilles malpropres » écoutant le chant de Philomèle, dans la section suivante. Le dernier paragraphe du poème est une version en français de l’épisode de Phlébas le Phénicien dans « Mort par l’Eau ». «The Hyacinth girl » aurait donc aussi pu se concevoir comme « la petite marchande de jacinthes », par association avec ce marchand noyé. Peut-être pourrait-on voir aussi dans ce personnage l’évocation de Hyacinthe (ici Hyacinthe fait fille, qu’on pourrait appeler « la jeune fille Hyacinthe », comme Claudel dit « la jeune fille Violaine ») comme figure mythique de résurrection sous forme de fleur, préfigurant le bourgeonnement du cadavre à la fin de la section. (NT)
[11] Les critiques se sont beaucoup demandé pourquoi elle avait les cheveux mouillés ; certains y ont vu une préfiguration d’Ophélie noyée ; peut-être peut-on ajouter à la note précédente une réminiscence du poème de Wordsworth « The Two April Mornings » où est évoqué le souvenir d’un homme qui, au moment où il venait de rendre visite à la tombe de son enfant morte, a eu la vision d’une jeune fille (réelle ou apparition ?) « A blooming Girl, whose hair was wet/With points of morning dew. » (NT)
[12] On trouvera un écho de ce vers dans la section suivante, aux vers 122-126.
[13] V. Tristan und Isolde, III, vers 24. (NP)
[14] Dans le roman d’Aldous Huxley, Crome Yellow (1921), un homme se déguise en magicienne sous le nom de Sésostris. Dans le poème cette ambivalence sexuelle se retrouvera chez Tirésias.
[15] Dans ses notes, Eliot dit avoir fait un usage assez libre des figures du Tarot, associant le Pendu à la fois au personnage encapuchonné qui apparaît « dans le passage des disciples d’Emmaüs dans la cinquième partie du poème » et au Dieu Pendu tel qu’il apparaît dans Le Rameau d’Or (The Golden Bough) de l’anthropologue Frazer, livre auquel, dans sa note liminaire, il se dit très redevable, ainsi qu’à From Ritual to Romance, livre que Jessie Weston consacre à la Légende du Graal. Le poète dit associer «l’homme aux trois bâtons » au Roi Pêcheur de la Légende du Graal mais n’indique pas de personnage spécifique du poème auquel le rattacher ; sans doute faut-il voir dans le Roi méhaigné dont la stérilité a entraîné celle de son royaume, non seulement le « je » qui pêche dans le canal au vers 189 ou celui du dernier paragraphe du poème, mais surtout une métaphore englobant l’ensemble des personnages du poème, comme le montrera la note 45 concernant Tirésias.
[16] Shakespeare, Chant d’Ariel dans La Tempête (I,ii,401) également associé par Joyce au thème du noyé (fin du chap.3, « Protée », 470). (NT)
[17] Peut-être y a-t-il ici une allusion à la Vierge aux Rochers de Leonard de Vinci, annonçant un possible retournement de la Belle Dame comme empoisonneuse (la belladone), ou comme naufrageuse circéenne (la tenancière du bordel de « Circé », dans Ulysse se nomme Bella Cohen) en potentielle rédemptrice, les conjonctures («situations », en anglais) étant toujours réversibles. (NT)
[18] Cf. Baudelaire , « Les Sept vieillards » :
‘Fourmillante cité, cité pleine de rêves,
‘Où le spectre en plein jour raccroche le passant.’ (NP)
[19] Cf. Inferno III, 55-57 :
si lunga tratta
di gente, ch’io non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta. (NP)
« une si longue troupe de gens, que jamais je n’aurais cru que la mort en eût tant frappé. » (La Divine comédie, vol. I, Enfer, Traduction Alexandre Masseron, Le club français du livre, 1964).
[20] Cf. Inferno IV, 25-27 :
Quivi, secondo che per ascoltare,
non avea piante mai che di sospiri
che l’aura eterna facevan tremare. (NP)
« Là, à en juger par l’ouïe, il n’y avait pas d’autres gémissements que des soupirs qui faisaient trembler l’air éternel. » (La Divine comédie, vol.I., Enfer, Trad. A. Masseron, op.cit.)
En face de ce vers Pound fait figurer les initiales J.J., qui semblent bien renvoyer à James Joyce, sans doute à son 6ème chapitre, «Hadès », où Bloom médite sur les morts enterrés dans le cimetière de Dublin. (NT)
[21] Ce nom évoque une bataille navale de la première guerre punique ; Eliot pensait peut-être ici à son ami Jean Verdenal à qui il avait dédié Prufrock and Other Observations en 1917 : « For Jean Verdenal, 1889-1915, mort aux Dardanelles. »
[22] Leopold Bloom, après l’enterrement de Paddy Dignam dans le cimetière de Dublin, médite sur le lien organique entre les cadavres du cimetière et le jardin botanique adjacent : « The Botanic Gardens are just over there. It’s the blood sinking in the earth gives new life. » « Le Jardin Botanique est juste à côté . C’est le sang qui, en s’enfonçant dans la terre, produit une vie nouvelle. »
[23] Le poète renvoie ici au chant funèbre dans The White Devil (Le Démon blanc), sans toutefois préciser que dans le texte de Webster il ne s’agit pas d’un chien ami de l’homme mais d’un loup qui en est l’ennemi. Je reprends le texte de Webster quelques vers plus haut car il y a utilisé « keep him warm » (tiendront (le cadavre) au chaud) que l’on retrouve dans « kept us warm » au vers 5 du texte d’Eliot:
« Appelez à cette charité funèbre
La fourmi, le campagnol et la taupe
Pour lui élever des monticules de terre qui le tiendront au chaud
Et puis, lorsque les jolies tombes seront pillées, ses restes seront à [l’abri ;
Mais éloignez le loup, qui est l’ennemi de l’homme. (NT)
Car de ses griffes il les déterrera. »
[24] V. Baudelaire, Préface aux Fleurs du mal. (NP)
On songera aussi à « Une charogne » où une chienne guette une charogne vouée aux amours deliquescents de la vermine. Voir, plus loin, les allusions au poème de Marvell, « To his coy mistress » (note 39).
[25] La traduction ne peut rendre justice à l’écho qu’Eliot introduit implicitement entre les mots game (jeu) et, dans la partie prolétarienne de cette section, gammon (jambon), vers 166, lui-même apparenté à « game » (gibier), qui suggère le côté prédateur de ce qui est en jeu dans les deux cas (les rapports entre les sexes).
[26] Cf. Antoine et Cléopâtre, II, ii, vers 190. (NP)
[27] Je garde « synthétiques » (trois syllabes) plutôt que « chimiques», car « synthetic » semble s’être malicieusement substitué à « exotic » qu’on aurait pu attendre comme qualificatif des parfums, pour mettre en évidence toute l’artificialité de la mise en scène, semblable à celle de Cléopâtre sur sa barge. (NT)
[28] Pour ce mot (un peu décalé lui aussi, mais cette fois par le pédantisme de son latin) qui signifie « plafond à caissons », le poète nous renvoie à L’Enéide, I, 726, dans le but, semble-t-il, d’établir une filiation entre Didon, Cléopâtre et la dame du poème, en tant qu’obstacles (induisant un sentiment de culpabilité) à la vocation «héroïque » (ou ici « poétique ») de leur partenaire amoureux . On peut aussi songer au palais de Lamia, la femme-serpent de Keats. (NT)
[29] Scène sylvestre, V . Milton, Paradise Lost, IV, 140 . (NP) Ce paysage sylvestre est celui du jardin d’Eden tel que le perçoit Satan au moment d’y pénétrer pour tenter Eve. (NT)
[30] V. Ovide, Les Métamorphoses, VI, Philomele. (NP)
[31] L’anglais « Jug jug » est bien le cri attribué au rossignol dans cette langue, mais les oreilles à la fois malpropres et lubriques l’entendent comme le « jig-jig » que proposent les prostituées à d’éventuels clients. On se souviendra à ce propos que l’ équivalence rossignol/prostituée se trouvait déjà dans un poème écrit en 1918, «Sweeney Among the Nightingales » ( Sweeney parmi les rossignols). Le « tio tio » du rossignol français ne permettant pas un retournement aussi évident du sens de la plainte de Philomèle vers sa cause lubriquement contemplée, j’ai d’abord pensé y substituer un « coït coït » qui en est un quasi palindrome, mais cette figure risquait d’échapper au lecteur et les mots eux-mêmes de lui apparaître trop brutalement explicites en même temps que de sonorité difficile à confondre avec le « tio tio » du rossignol, là où, chez Eliot, la brutalité va toujours masquée derrière l’écran de l’ambiguïté (comme ici dans le double sens, à la fois physique et moral, des « dirty ears » qui leur permet de mal entendre et d’entendre à mal tout à la fois); j’ai finalement préféré une allusion au mouvement du yoyo, renforcé par les points d’exclamation qui renvoient à la brutalité de l’acte, car ce qu’entendent en fait les oreilles salaces, ce n’est pas tant l’appel à l’acte sexuel que la ‘gigue’ que dansent hardiment deux corps accouplés, d’où la tentation, finalement rejetée d’ajouter un « gigue la gigue » à mon moins explicite yoyo, ajout calqué sur le « twit-twit, jug-jug » de la section suivante.
[32] Cf. Webster : « Is the wind in that door still ? » (Est-ce que le vent sous la porte s’est calmé ?) (NP)
[33] « Rag » renvoie à la fois à l’idée d’une guenille (ici un lambeau éculé de texte) et aux rythmes syncopés du « ragtime » des années 20. (NT)
[34] Cf. la partie d’échecs dans Women beware Women de Middleton. (NP) qui permet la perpétration d’un viol en coulisses. (NT) L’épisode consacré à Lil se termine en écho (autre classe, autre « game ») par la consommation jouissive d’un « hot gammon »
[35] Dans une note en marge du manuscrit de cette partie du poème Eliot s’interdit de jouer sur l’orthographe des mots pour en rendre le côté délibérément populaire ; cela m’a semblé une gageure difficile à tenir en français. (NT)
[36] Cf. Hamlet, IV, 5. Ce sont les pathétiques paroles d’adieu d’Ophélie, folle, aux dames de la cour du roi de Danemark. Hamlet a accusé Ophélie d’être une putain et lui a dit de se retirer dans une «nonnerie » — mot d’argot pour « bordel » au temps de Shakespeare. (Note de John Hayward). C’est ce même double sens que l’on trouvait déjà dans les « jug jug » de Philomèle, selon que le point de vue est celui de la victime ou celui des partisans du violeur. V. note 29.
[37] V. le Prothalamion de Spenser. (NP)
[38] Une partie du poème a été écrite à Lausanne, alors que le poète y faisait soigner une dépression nerveuse. J’y verrais volontiers un écho du désespoir du monstre de Frankenstein qui, lui aussi, s’assit au bord du même lac pour pleurer son incapacité à trouver sa place parmi les humains ; la plupart des critiques y voient une allusion à la captivité de Babylone . Comme le plus souvent, chez Eliot, plusieurs allusions, dont certaines sont parfois contradictoires, peuvent se superposer. (NT)
[39] Allusion au poème de Marvell « A sa trop farouche maîtresse » (« To His Coy Mistress ») où le char du temps va précipiter les amants dans la mort et vouer la dame trop chaste à la défloration post mortem par les vers. (NT)
[40] Reprise du texte de Marvell, ici combiné, pour introduire Sweeney et Mrs Porter, à un texte du « Parliament of Bees » de Day où la dame est Diane, la déesse interdite et l’amant Actéon dévoré par ses chiens pour avoir voulu transgresser l’interdit. (NT) Eliot cite le texte dont voici la traduction :
Lorsque, dressant l’oreille, soudain vous entendrez
Un bruit de chasse et de trompes qui mènera
Actaeon vers Diane au printemps Alors tous verront sa peau nue…
[41] Sweeney apparaît, assorti d’images de bestialité, dans deux autres poèmes, « Sweeney Among the Nightingales », (Little Review, V, 5, sept. 1918) où les rossignols sont associés à des prostituées interlopes, un couvent du Sacré Cœur et l’assassinat d’Agamemnon, et « Sweeney Erect », (Art and Letters, II,3, été 1919) où se trouvent juxtaposées, un peu comme dans « Une partie d’Echecs », deux scènes de désolation liées à la défloration et à l’abandon d’une femme, la première dans la belle langue du mythe mettant en scène Aspasie (The Maid’s Tragedy de Beaumont et Fletcher) et Ariane abandonnée par Thésée, dans un paysage de désolation, de stérilité et de fuite et la seconde une femme hystérique se tordant sur un lit de garni, sinon de bordel, après le retrait d’un Sweeney plutôt cynique. Sweeney reparaîtra plus tard dans Sweeney Agonistes.
[42] Eliot dit ne pas connaître l’origine de cette ballade qui lui fut envoyée d’Australie. Savait-il que le texte n’en était pas, semble-il, «They wash their feet », mais « They wash their arse » (Elles se lavent le cul ) ? Cet usage d’un double référent relevant l’un du sexuel et l’autre du sacré (hérité d’une tradition perpétuée par Shakespeare) n’est pas étrangère au poète. (NT)
[43] V. Verlaine, « Parsifal ». (NP) Ce texte n’est pas lui-même sans ambiguïté. (NT)
[44] Coût Assurance Fret. Les raisins étaient cotés « tranport et assurance payés jusqu’à Londres » ; et la police de chargement, etc., devait être remise à l’acheteur contre paiement de la traite à vue. (NP)
[45] Tirésias, quoiqu’il soit ici simple spectateur et point du tout un personnage, n’en est pas moins la figure la plus importante du poème, celle en qui s’unissent toutes les autres. De même que le marchand borgne, vendeur de raisins secs, se confond avec le Marin Phénicien, et que celui-ci, n’est pas entièrement distinct de Ferdinand, Prince de Naples, de même toutes les femmes ne sont qu’une femme, et les deux sexes se rencontrent en Tirésias. Ce que Tirésias voit est en fait la substance du poème. Tout le passage, chez Ovide, est d’un grand intérêt anthropologique. (NP) .
Suit alors une longue citation des Métamorphoses où Ovide raconte comment, chargé de trancher entre Jupiter et Junon sur la question de savoir qui de l’homme ou de la femme éprouvait le plus de plaisir dans l’union sexuelle, Tirésias frappa de son bâton deux serpents accouplés et se trouva transformé en femme ; sept ans plus tard il frappa à nouveau les deux serpents et retrouva son sexe initial ; il annonça alors que le plaisir était, comme l’avait dit Jupiter, du côté des femmes ; ce dont il fut puni par Junon qui lui ôta la vue ; en compensation, il reçut alors le don de voyance.
Dans Ulysse de Joyce c’est Bloom qui change de sexe dans l’épisode de « Circé » qui se passe dans le bordel de Bella Cohen. (NT)
[46] Dans le texte d’Eliot, où il est introduit comme « the young man carbuncular », le qualificatif « carbuncular » peut renvoyer à deux choses : d’abord, dans un sens actuellement peu usité, à l’éclat du grenat, comme dans notre mot « escarboucle », sens qu’avait utilisé Milton, pour décrire l’éclat à la fois séducteur et diabolique des yeux de Lucifer, brillant comme des charbons ardents, dans Le Paradis Perdu, IX, 500 , « carbuncle his eyes », en ayant probablement à l’esprit les yeux de Pyrrhus, « With eyes like carbuncles, the hellish Pyrrhus », dans la pièce dans la pièce, dans Hamlet (II,ii, 468) ; mais surtout, en son sens moderne, aux boutons d’acné, comme l’atteste d’ailleurs le manuscrit du poème où le jeune homme était d’abord décrit comme « A youth of twentyone, spotted about the face », « Un jeune homme de vingt et un ans, au visage boutonneux », avant de reparaître, huit vers plus loin, sous la forme « He, the young man carbuncular » (The Waste Land, a facsimile and transcript of the original drafts, ed. Valérie Eliot p. 33). En associant implicitement ces deux sens du mot, Eliot peut avoir, plus ou moins consciemment, songé au Blazes Boylan de Joyce, le séducteur de Molly Bloom dans Ulysse, où « Blazes » pourrait renvoyer à l’éclat des yeux (et, par métonymie, à l’ensemble du personnage) et « Boylan » à sa fougue bouillonnante, mais aussi, dans l’imaginaire éliotien à des furoncles, « boils ». Le génie d’Eliot a superposé les deux sens dans le seul « carbuncular » dont je n’ai su trouver d’équivalent en français, car un mot tel que «rutilant » ne m’aurait pas pour autant permis de faire l’économie de « boutonneux », ce qui eût introduit une hésitation sur le statut de nom ou d’adjectif de ce dernier mot, d’où mon recours, certes un peu faible, au « visage en feu », qui peut néanmoins implicitement inclure et les boutons et les yeux de braise. (NT)
[47] V. Goldsmith, la chanson du Vicar of Wakefield. (NP)
[48] La Tempête, I, ii, 394. (NT)
[49] L’intérieur de Saint-Magnus Martyr est, à mon sens, l’un des plus beaux de Wren. (NP)
[50] Ici commence la chanson des (trois) filles de la Tamise. Elles parlent alternativement, du vers 292 au vers 306. Voir Gotterdämmerung, III, i : Les Filles du Rhin. (NP)
[51] V. Froude, Elisabeth, vol. I, ch. iv, lettre de De Quadra à Philippe d’Espagne :
« L’après-midi nous trouva sur une nacelle, occupés à regarder les jeux nautiques. (La reine) était seule avec Lord Herbert et moi-même à la poupe, et ils se mirent à badiner, tant et si bien que Lord Herbert alla jusqu’à dire, en ma présence, qu’il n’y avait pas de raison pour qu’ils ne se mariassent pas si la reine l’avait pour agréable. » (NP)
[52] Cf. Purgatorio, V, 133 :
« Ricorditi di me, che son la Pia ;
Siena mi fe, disfecemi Maremma . » (NP)
« souviens-toi de moi qui suis la Pia ! Sienne m’a vue naître, la Maremme mourir. » (La Divine comédie, vol. II, Purgatoire, Trad. A. Masseron, op.cit.)
[53] Voir St . Augustin, Confessions : « Je m’en fus alors à Carthage, où un chaudron d’amours impures m’emplit les oreilles de son chant. » (NP)
[54] Le Poète renvoie ici au Sermon sur le Feu du Bouddha dont il nous dit qu’ il « correspond en importance au Sermon sur la Montagne.» Ce qu’y enseigne le Bouddha c’est que toutes choses sont en feu, y compris nos perceptions et que ce feu est celui de la colère, de la haine et de l’attachement déraisonnable. (NT)
[55] Cf. encore Les Confessions de Saint Augustin. Le rapprochement de ces deux représentants de l’ascétisme oriental et occidental, au point culminant de cette partie du poème, n’est pas fortuit. (NP)
[56] Cf. le texte d’Eliot qui conclut le poème en français, « Dans le Restaurant » :
Phlébas, le Phénicien, pendant quinze jours noyé,
Oubliait les cris des mouettes et la houle de Cornouaille,
Et les profits et les pertes, et la cargaison d’étain :
Un courant de sous-mer l’emporta très loin,
Le repassant aux étapes de sa vie antérieure.
Figurez-vous donc, c’était un sort pénible ;
Cependant, ce fut jadis un bel homme, de haute taille.
Il y a aussi un noyé qui hante les premiers chapitres d’Ulysse, en association avec la chanson d’Ariel, « Full fathom five thy father lies / Those are pearls that were his eyes » dans La Tempête. Voir en particulier la fin du chapitre 3 (Protée). (NT)
[57] Au début de la cinquième partie, il est fait usage de trois thèmes : le voyage à Emmaüs, la marche vers la Chapelle Périlleuse (voir le livre de Miss Weston) et le présent déclin de l’Europe orientale. (NP)
Ici , comme ailleurs dans le poème, la référence à la Quête du Graal (qui, rappelons-le, n’est entrée que très tard dans le processus de composition du poème) sert pour une part à masquer la dette envers Joyce, car le mystérieux personnage encapuchonné de brun qu’Eliot associe ici au Christ ressuscité y donne lieu à des supputations similaires à celles que suscite « l’Homme à l’imperméable brun » de Joyce, aux apparitions et disparitions jamais expliquées. (NT)
[58] Les vers suivants ont été inspirés par le récit d’une expédition antarctique (je ne sais plus laquelle, mais je crois bien que c’était l’une des expéditions de Shackleton) : on y rapportait que les explorateurs, à bout de forces, avaient constamment l’illusion d’être un de plus qu’ils ne pouvaient compter. (NP)
Ceci m’apparaît une fois encore comme une note écran. Voir note précédente. Bloom a compté 12 têtes et tout d’un coup il y en a une treizième. « Monsieur Bloom se tenait en arrière, chapeau à la main et comptait les têtes nues. Douze. Je suis le treizième. Non. Treize c’est le type à l’imperméable ; Le chiffre de la mort. D’où diable est-ce qu’il a bien pu sortir ? Il n’était pas dans la chapelle, j’en jurerais…» (NT)
[59] Le poète associe les vers qui suivent à ce que décrit Hermann Hesse dans Blick ins Chaos.
[60] Cette chapelle et ces tombes culbutées, de même que les chauve-souris du paragraphe précédent, me semblent provenir de Dracula de Bram Stoker, tout autant que de Jessie Weston. Le poète aurait par ailleurs mentionné un souvenir de Jérôme Bosch. (NT)
[61] « Datta, dayadhvam, damyata » (Donne, compatis, dirige). La fable sur la signification du Tonnerre se trouve dans le Brihadaranyaka-Upanishad, 5,1. Elle est traduite dans Sechzig Upanishads des Veda par Deussen, p.489. (NP)
[62] Cf. Webster , The White Devil, V, vi « …Ils se remarieront/ Avant même que le ver n’ait percé ton linceul, avant que l’araignée/ N’ait enrobé ton épitaphe. » (NP).
[63] Cf. Inferno, XXXIII, 46 :
« ed io sentii chiavar l’uscio di sotto/ all’orribile torre .» (NP) « et j’entendis clouer la porte au bas de l’horrible tour. » (Trad. A. Masseron, op.cit.)
Le poète renvoie également à un passage d’Appearance and Reality de Bradley (p.346) sur lequel il avait écrit sa thèse de philosophie.
[64] Eliot considérait Antoine et Cléopâtre et Coriolan comme les deux meilleures pièces de Shakespear. (Voir l’essai de 1919 sur Hamlet). Il consacrera lui-même deux poèmes à Coriolan, dont le deuxième, «Difficulties of a Statesman », le montre appelant sa mère au secours au moment de la défaîte.
[65] V . Weston : From Ritual to Romance ; le chapitre sur le Roi Pêcheur. (NP)
[66] Refrain d’une comptine.
[67] V. Purgatorio, XXVI, 148.
‘« Ara vos prec, per aquella valor
« que vos guida al som de l’escalina
« sovegna vos a temps de ma dolor. »
Poi s’ascose nel foco che gli affina.’ (NP)
« Puis il se cacha dans le feu qui les purifie » (La Divine comédie, vol. II , Purgatoire, Trad. A. Masseron, op.cit.)
[68] Voir Pervigilium Veneris. Cf. Philomela in parties II et III. (NP)
« Quand surviendra le printemps pour moi ? quand serai-je comme l’hirondelle pour n’être plus silencieuse ? j’ai perdu la muse dans le silence, et Apollon n’a plus de considération pour moi. »
[69] Voir Gérard de Nerval, le sonnet El Desdichado. (NP)
[70] Voir Kyd, The Spanish Tragedy, IV, i, 68 . (NP)
Le texte de Kyd est à double sens. Ce que Balthazar et Lorenzo sont censés comprendre c’est que Hieronymo va leur fournir la pièce de théâtre dont ils ont besoin ; ce qu’il veut faire entendre au spectateur c’est qu’il va leur régler leur compte ; il leur dira d’ailleurs plus loin, vers 131, que c’est lui qui jouera le rôle du meurtrier dans la pièce. On remarquera aussi que Hieronymo demande que chacun des personnages joue dans une langue différente, vers 168-174, comme le fait notre poète dans les vers qui précèdent (dont l’un est en italien, l’autre en latin et le troisième en français) et il s’exclame, face à cette babelisation que lui emprunte Eliot : « Maintenant vais-je voir la chute de Babylone/Ouvrée par le Ciel en cette confusion », vers 190-191. (NT)
[71] Répété comme ici, Shantih constitue la fin rituelle d’une Upanishad. « La paix qui passe l’entendement serait notre équivalent pour ce mot. » (NP)
Monique Lojkine-Morelec, Professeur émérite de l’Université Paris IV – Sorbonne (aujourd’hui Sorbonne Université), est l’auteur de T.S. Eliot : Essai sur la genèse d’une écriture (Klincksieck/Publications de la Sorbonne, 1985).